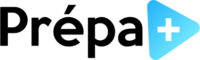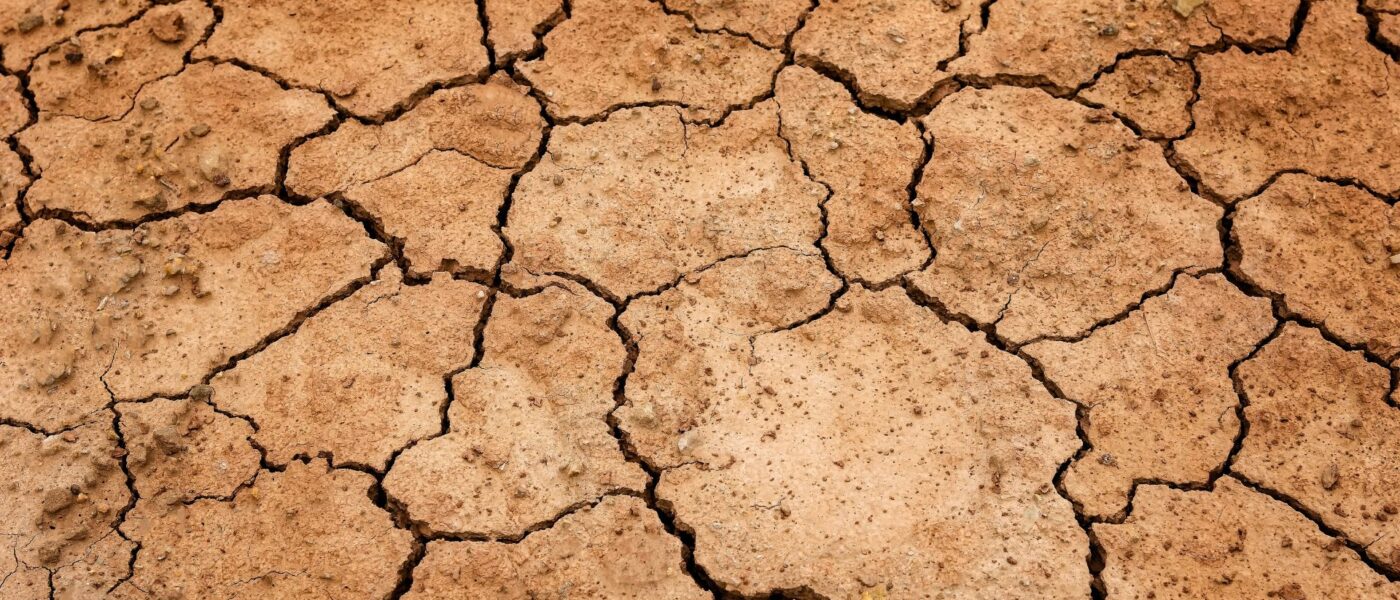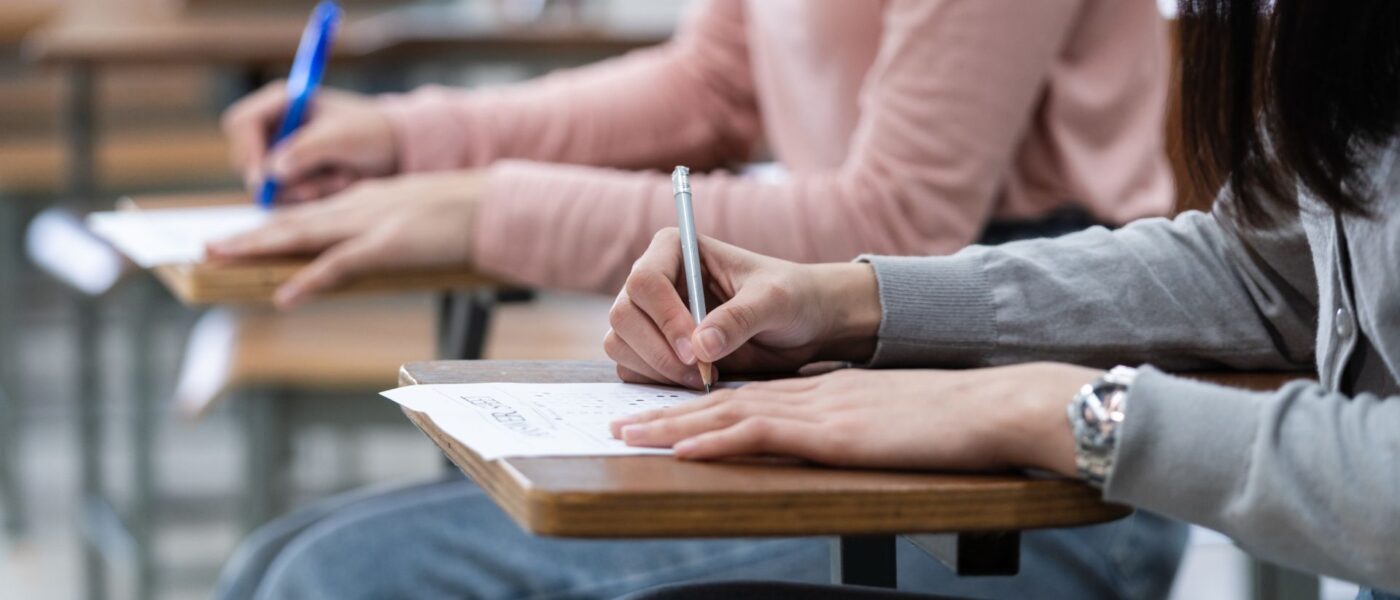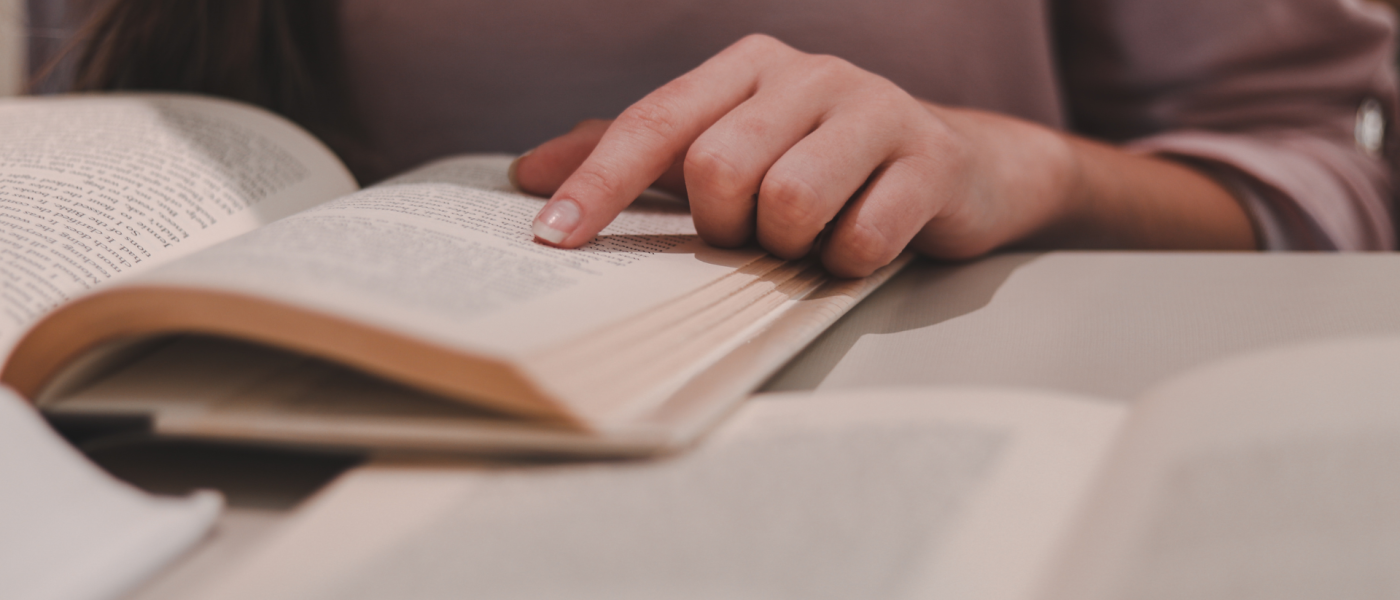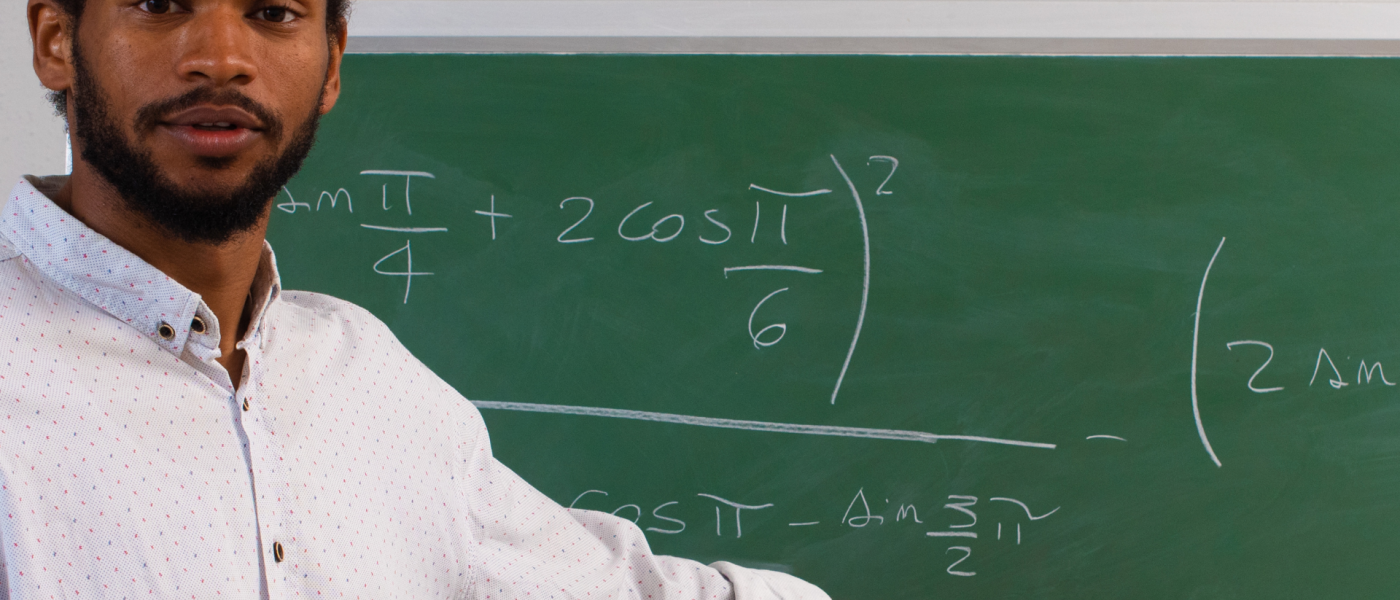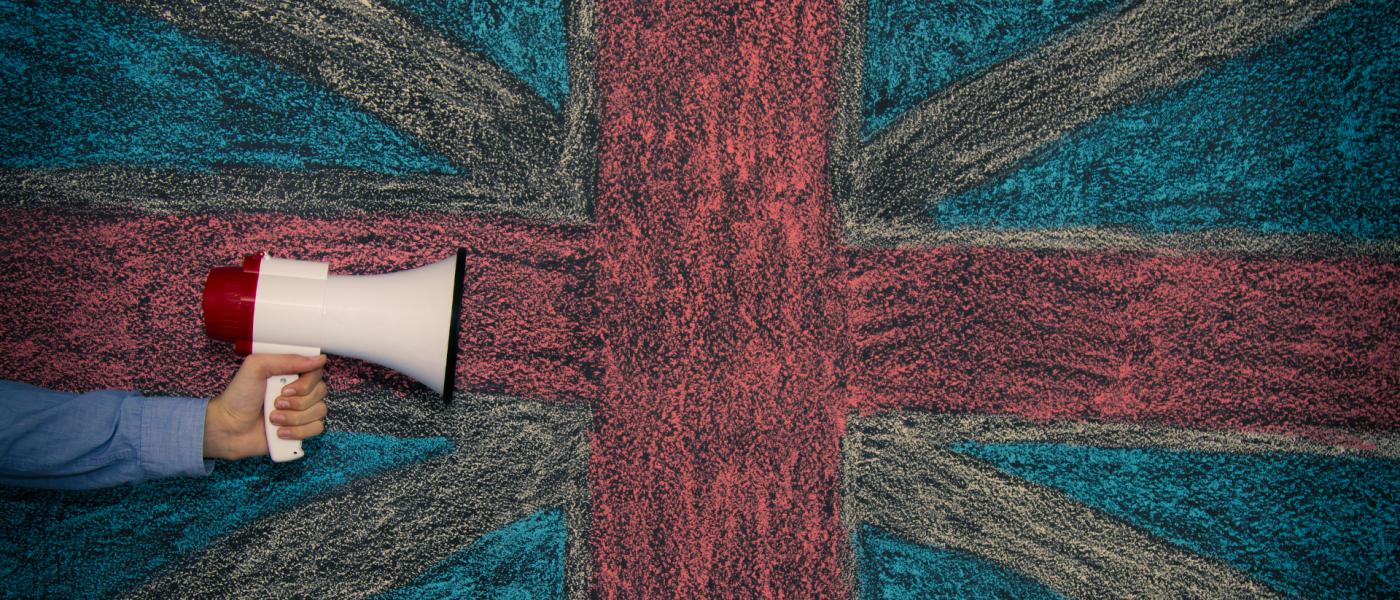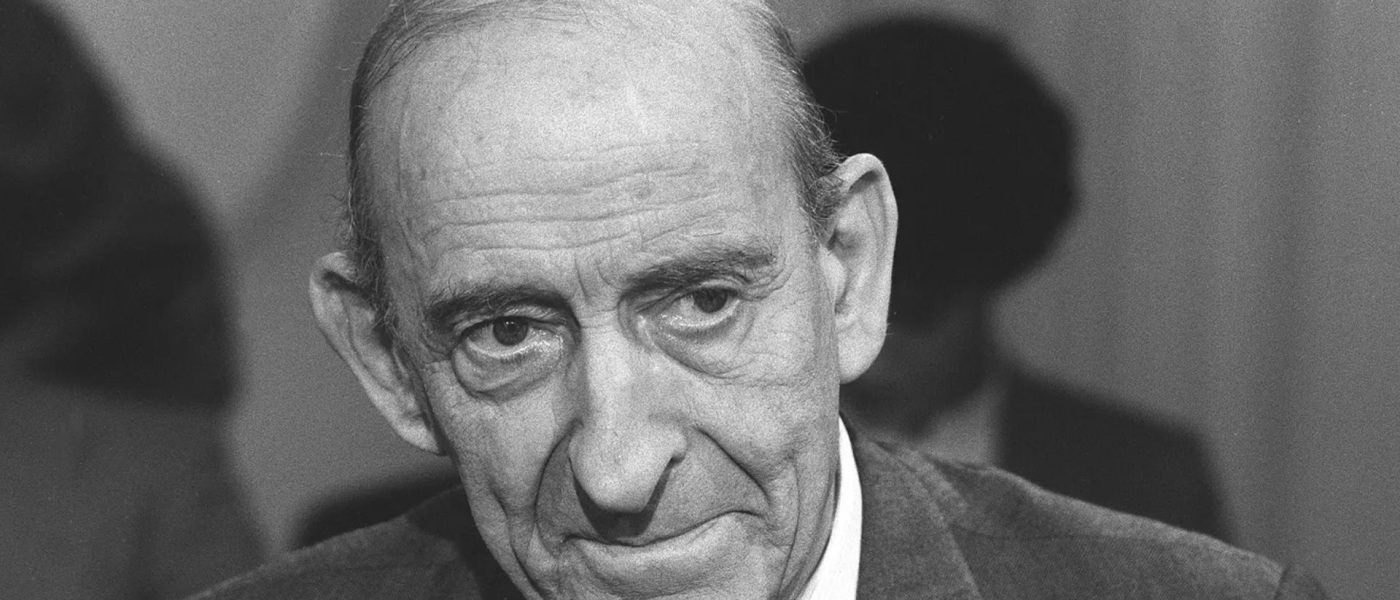Les accords d’Abraham signés en septembre 2020 à la Maison Blanche représentent un big bang géopolitique important pour la région. En effet, sous l’égide du président Trump, l’allié israélien normalise ses relations avec certains des pays arabes, ennemis ou adversaires de l’État hébreu depuis sa création en 1948. Cet accord est donc historique, mais s’il diminue le risque de conflits entre Israël et ses voisins, il met cependant de côté le problème palestinien. Le 7 octobre 2023 et l’attaque terroriste du Hamas mettent en lumière les manquements de cet accord et des politiques israéliennes depuis la signature d’Oslo en 1993.
Ainsi, les cartes sont rebattues, il faut désormais repartir d’une nouvelle base pour créer une paix durable entre Palestiniens et Israéliens. Néanmoins, si l’actualité récente place ce conflit au centre des préoccupations internationales, d’autres dynamiques sont aussi à l’œuvre au PMO (Proche et Moyen Orient). Un rapide tour d’horizon s’impose donc pour mieux saisir les enjeux régionaux et mondiaux qui impliquent cette partie du globe.
Lire plus : Géopolitique : Un Moyen-Orient en recomposition
Israël-Palestine, un problème sans fin
Comme nous l’avons vu en introduction, l’attaque du 7 octobre avec les 1200 victimes et les 137 otages encore captifs mettent fin à une situation de « paix » précaire entre les autorités conservatrices de l’État hébreu et celle du mouvement islamiste, le Hamas qui dominent la bande de Gaza. En réponse à cet acte terroriste, Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, décide de répliquer violemment en bombardant la bande de Gaza puis en envoyant les forces de Tsahal au sol, ce qui a provoqué la mort de 34 735 personnes à la fin mai 2024 (source UNICEF).
Mais finalement quels résultats et conséquences, si ce n’est les victimes innocentes de part et d’autre de la ligne de front ? Les gains sont plus que minimes. En effet, si l’attaque du Hamas replace au centre du jeu la question de la création d’un État palestinien, cela ne fait pas pour autant avancer les pions. Un des objectifs était sûrement de stopper le processus de normalisation des relations diplomatiques en cours avec Israël afin de rompre le relatif isolement diplomatique des Palestiniens (du fait d’une réplique violente et prévisible d’Israël qui aurait dû faire basculer l’opinion des peuples et gouvernements arabes vers les intérêts du Hamas).
Le processus est ralenti avec l’Arabie Saoudite, mais pas abandonné et de plus, les pays ayant déjà normalisé leurs relations comme les Émirats Arabes Unis ou le Maroc n’ont pas rompu leurs relations. De la même façon, le support des alliés du Hezbollah et de l’Iran n’a pas eu d’effets significatifs pour la conduite des opérations de Tsahal. Le pari du Hamas semble donc avoir échoué.
Pour aller de l’avant, il faudrait probablement avancer vers une solution à deux États, mais pour le moment celle-ci parait impossible. Le Hamas, du fait de son entreprise terroriste, ne peut apparaître comme un interlocuteur crédible et sécurisant pour Israël et n’a d’ailleurs pas véritablement vocation à fonder un Etat stable puisque cela risquerait d’affaiblir sa mainmise sur le peuple palestinien. La question est donc la suivante : quel interlocuteur ? Le Fatah de Mahmoud Abbas installé en Cisjordanie ? Peu probable, cette autorité est faible et corrompue, de fait, elle n’est plébiscitée ni par les Israéliens ni par les Palestiniens lassés par presque 30 ans de déconvenues avec le Fatah.
Il n’y a donc vraisemblablement pas de « bon interlocuteur palestinien » aux yeux de l’État hébreu. Enfin, si tant est que Tel-Aviv souhaite un dialogue pour avancer en cette direction. La coalition gouvernementale de Netanyahu dominée par la droite conservatrice et l’extrême droite religieuse ne souhaite pas de cette option, cela est démontrée par les frappes sans autre objectif stratégique que de détruire la bande de Gaza.
Or, les interventions américaines en Afghanistan, françaises au Sahel démontrent bien une chose : on ne détruit pas par les armes une idéologie reposant sur la misère des peuples. Une victoire militaire ne signifie pas une victoire politique.
Le retour de la Syrie dans le jeu régional, un tournant majeur ?
7 mai 2023, les pays membres de la ligue arabe décident d’un retour de la Syrie dans l’organisation internationale, plus de 10 ans après son exclusion en 2011 à la suite des exactions du régime de Bachar el Assad envers sa population. Cette réintégration devait marquer le grand retour de la Syrie au sein du concert des nations ainsi que de nombreux investissements nécessaires pour la reconstruction de ce pays dévasté par plus de 10 ans de guerre civile. Néanmoins, il semblerait que les attentes du régime aient été au-dessus des résultats.
Les points de désaccords avec les pays membres de l’organisation sont encore nombreux. On compte parmi eux les problèmes du trafic de drogue et notamment celui du Captagon qui représente pour le régime de Damas une importante source de revenus et pour les autres pays du Golfe, une source de dangers puisque les jeunes populations plébiscitent de plus en plus cette drogue. Nous pourrions également souligner la proximité de la Syrie avec l’Iran et ses milices satellites.
De cette façon, malgré la façade d’une unité retrouvée, la Syrie reste tout de même sur le banc des nations du PMO. De cette réintégration partielle, on notera le faible investissement des pays du Golfe en Syrie (14 entreprises en 2023) et le peu de changements en ce qui concerne la tectonique des plaques géopolitiques moyen-orientales.
Iran-Arabie Saoudite, un retour au calme précaire ?
Le rétablissement des relations diplomatiques entre les 2 grands rivaux du PMO le 10 mars 2023 sous l’égide de Pékin est un coup diplomatique majeur pour la Chine qui se place désormais comme un acteur crucial du grand jeu géopolitique au PMO. L’Iran et l’Arabie Saoudite normalisent donc leurs relations après plusieurs années de très fortes tensions. Faut-il y voir la fin d’une rivalité entre les deux géants de la région ? Non, mais plutôt un recalibrage des priorités des deux protagonistes.
Les 2 puissances ont besoin d’un certain calme pour se développer, avec d’un côté le projet NEOM de l’Arabie Saoudite et de l’autre une tentative de rompre avec l’isolement politique et économique notamment grâce aux investissements chinois (400 Mds de dollars sur 25 ans en échange d’un pétrole à prix avantageux, source Les Echos).
La rivalité perdure donc, mais elle est légèrement mise de côté pour des questions intérieures. Le régime des Mollah en Iran ne peut en ce moment pas se permettre de s’opposer fermement à Israël, de soutenir ses alliés en Irak, Syrie et Yémen tout en satisfaisant une population qui semble désormais nettement moins favorable à un régime archaïque et imperméable, comme peuvent en témoigner les révoltes de 2022. Il y a donc des choix à faire en termes de politique étrangère, et l’apaisement avec le voisin saoudien est le plus logique du fait de l’opposition « à mort » avec Israël.
De la même façon, la mort du président ultraconservateur iranien Ebrahim Raïssi le dimanche 19 mai ne devrait pas changer radicalement la donne, puisque les élections qui s’annoncent pour le remplacer devraient mener à un autre homme du même bord à la présidence de l’Iran. Une question plus délicate émerge cependant en Iran : qui va succéder à l’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême âgé de 85 ans.
La chose la plus notable est peut-être l’impact de la Chine. Cet accord irano-saoudien démontre la nouvelle puissance diplomatique de l’Empire du Milieu au PMO ainsi que le déclin des Etats-Unis, incapables de pacifier les relations. Cette supervision n’est pas le premier jalon posé par la Chine dans la région puisque déjà en 2022, l’Arabie Saoudite annonçait accepter le yuan comme monnaie d’échange, et ce, au détriment du roi dollar.
In fine, le PMO semble devoir rester durablement une poudrière du monde, les problèmes majeurs de la région ne sont pas réglés et si des accalmies sont visibles aujourd’hui, il est probable qu’elles ne soient que conjoncturelles et non-durables. La question palestinienne demeure un enjeu majeur, de même que le relèvement et la réintégration des États faillis de la région qui restent sources de nombreux défis. Le tout, où chaque pays et groupuscules, représentent une pièce de l’échiquier géopolitique américain et chinois.
Nous remercions l’association GEM ONU, partenaire de Mister Prépa et un de ses rédacteurs François Forquet, pour l’écriture de cet article.
Pour suivre les actus de GEM ONU, c’est ici que ça se passe :