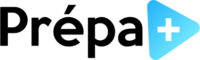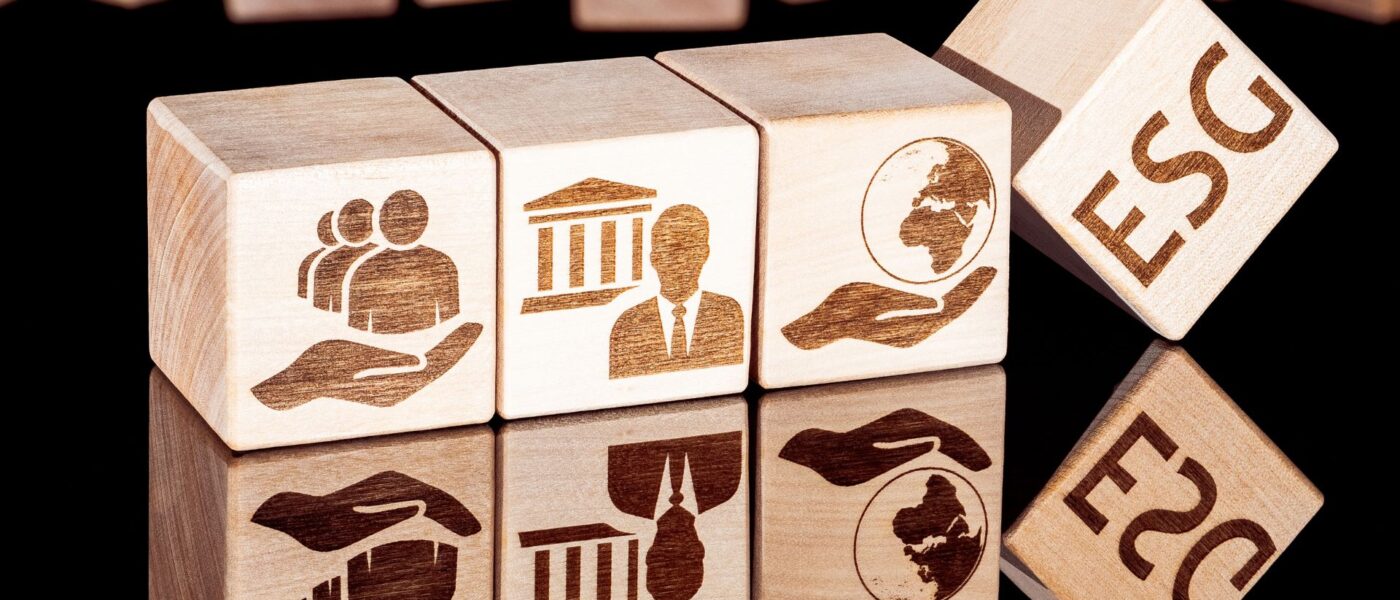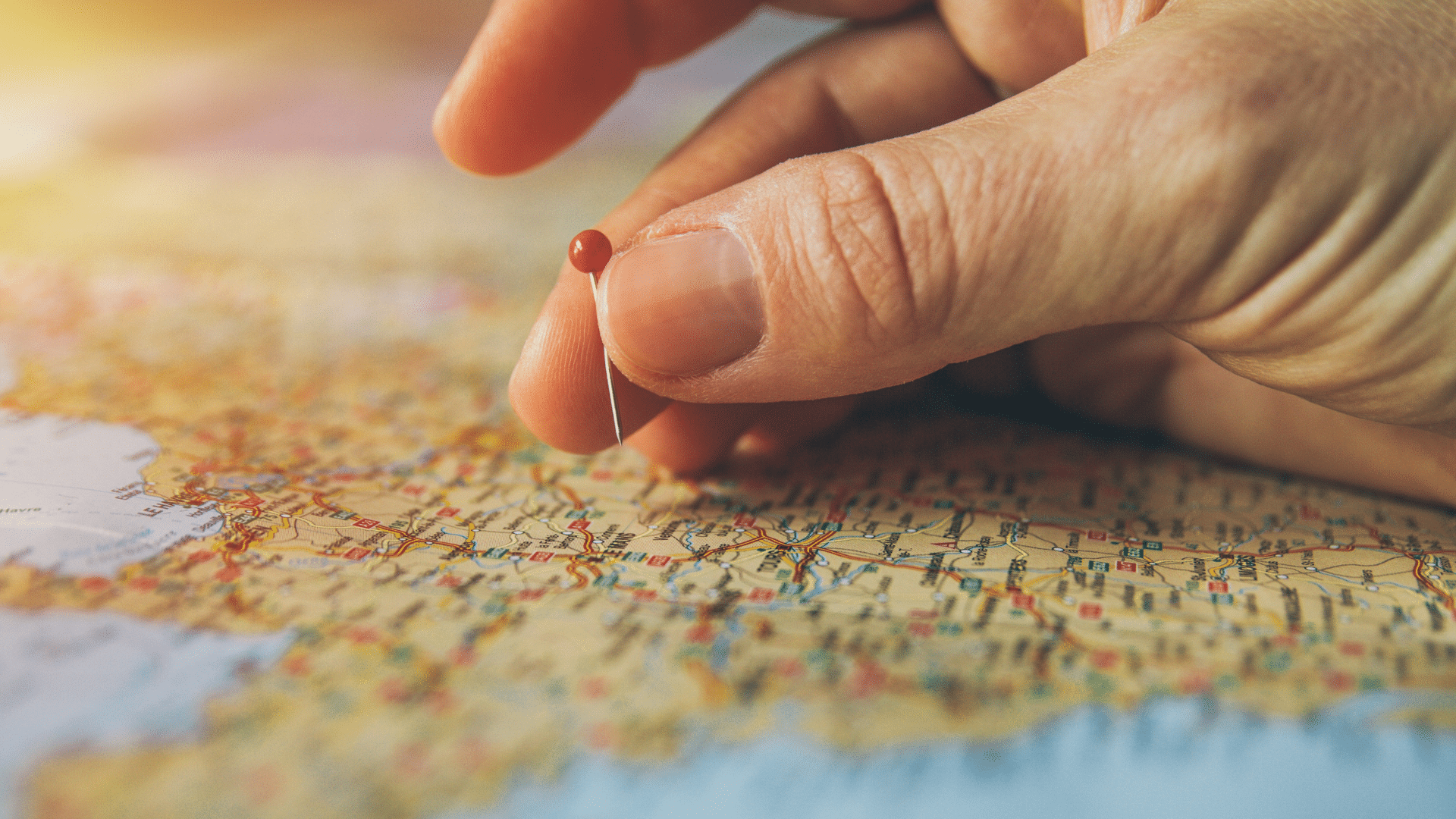Les soldes intermédiaires de gestion également appelés (SIG) constituent une partie indispensable pour réussir en classe préparatoire, et plus particulièrement au concours, dans la partie comptabilité-finance. En effet, chaque année, quelle que soit la banque d’épreuves (Management HEC, ECRICOME, INSEEC/EM Normandie), on rencontre des questions portant sur cette notion, ayant pour but de proposer un diagnostic de la situation financière de l’organisation qu’il vous est demandé d’analyser. La probabilité de rencontrer des questions portant sur ce sujet est extrêmement forte. Vous devez prêter une attention très minutieuse à vos calculs. Ces derniers sont en chaîne, cascade une faute faussera l’intégralité des calculs suivants.
Lire plus : Une finance éthique existe-t-elle ?
Les différents calculs composant les soldes intermédiaires de gestion
- La marge commerciale (1) : Ventes de marchandises – coût d’achat des marchandises vendues (=achat de marchandises + variation de stocks de marchandises).
- La production de l’exercice (2) : Ce sont l’ensemble des productions (production vendue + production stockée + production immobilisée).
- La valeur ajoutée (3) : Production de l’exercice (2) – consommations intermédiaires en provenance des tiers ( achats de matière premières et autres approvisionnements + variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements + autres achats et charges externes).
- L’excédent brut d’exploitation (4) : Valeur ajoutée (3) + subvention d’exploitation – impôts, taxes, versements assimilés – les charges du personnel (c’est à dire les salaires et les charges sociales).
- Le résultat d’exploitation (5) : L’excédent brut d’exploitation (4) + reprises sur charges + autres produits d’exploitation – dotation aux amortissements et provisions – les autres charges d’exploitation.
- Le résultat courant avant impôt (6) : Résultat d’exploitation (5) + produits financiers – charges financières.
- Le résultat exceptionnel (7) : Produits exceptionnels – charges exceptionnelles.
- Le résultat de l’exercice (8) : Résultat courant avant impôt (6) + le résultat exceptionnel (7) – participation des salariés au résultat – impôt sur les bénéfices.
La capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement représente le montant des ressources générées par l’entreprise, disponibles pour financer ses investissements ou rembourser ses dettes, après avoir pris en compte les charges non décaissées et les produits non encaissés. Elle fait partie des indicateurs clés de la rentabilité financière.
- Méthode n°1 : Résultat de l’exercice + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions – reprises sur dépréciations et provisions – valeur comptable des éléments d’actifs cédés – les produits de cession des éléments d’actifs cédés – quote part d’investissement virées au résultat.
- Méthode n°2 : L’excédent brut d’exploitation (EBE) + les produits encaissables – les charges décaissables.