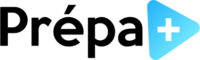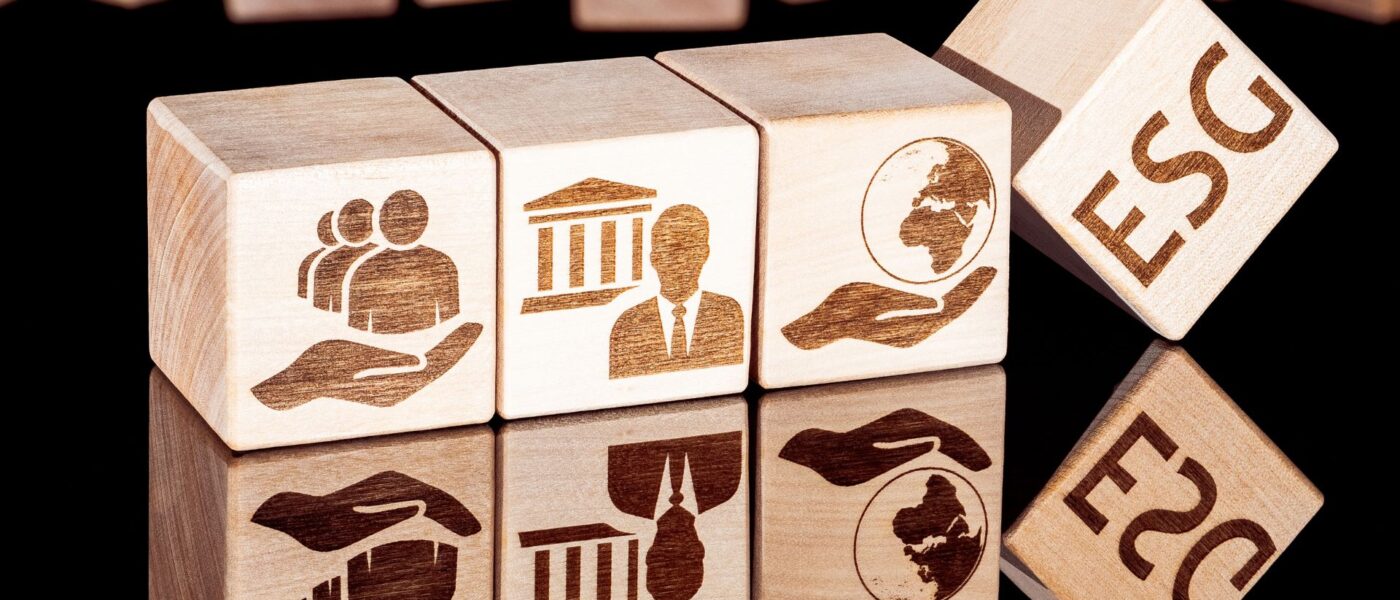« La pertinence de l’Alliance atlantique a été remise en question. Elle a été considérée comme divisée, obsolète, frappée de mort cérébrale. Mais la réalité est que l’OTAN est forte, unie et plus importante que jamais ». Tels sont les propos tenus par Jens Stoltenberg, ex-secrétaire général de l’OTAN. En septembre 2024, à quelques jours de la fin de son mandat, l’homme politique s’inquiétait des tendances isolationnistes de certains membres de l’institution depuis le début du XXIème siècle. Ces propos s’inscrivent dans un contexte tendu, où l’OTAN est confrontée aux défis contemporains et à l’émergence de nouvelles puissances, pour le moins anti-occidentales.
Si l’organisation est née dans un contexte de Guerre froide, avec pour mission première une défense collective face à l’expansionnisme soviétique, son rôle et sa pertinence ont été réévalués au fil des décennies. En effet, alors que plusieurs États se posent en ennemis de cette coalition du siècle dernier, certains membres de l’OTAN entretiennent des désaccords au sein même de l’alliance.
Dès lors, la pérennité de l’OTAN est aujourd’hui hautement questionnée. À l’heure où les tensions géopolitiques se ravivent et où l’unité interne vacille, l’OTAN se trouve à la croisée des chemins : institution obsolète ou acteur clé de la stabilité mondiale ?
Origines et missions premières de l’OTAN (1945-1949)
L’OTAN est une alliance politico-militaire constituée de pays européens et nord-américains. Ses membres s’engagent à se protéger mutuellement contre toute menace.
La Seconde Guerre mondiale, le dernier des conflits ?
En 1945, les États-Unis et l’Union soviétique libèrent une partie de l’Europe et de l’Asie. Mais au-delà de ce tableau chimérique d’un monde apaisé se cache une réalité bien plus complexe. Passée l’euphorie de la chute des totalitarismes, des rivalités émergent rapidement entre les superpuissances américaine et soviétique.
Ce climat de méfiance, exacerbé par les idéologies radicalement opposées des « deux grands », marque le début de la Guerre froide. Dès lors, tandis que l’Union soviétique étend son influence sur l’Europe de l’Est, les États-Unis, pour leur part, cherchent à protéger les démocraties occidentales et à contenir le communisme.
Lire plus : Le maccarthysme, peur rouge du communisme aux États-Unis
L’OTAN, une alliance politique et militaire défensive
Face à la menace soviétique grandissante, les Etats-Unis et plusieurs pays d’Europe occidentale décident de s’unir autour d’une alliance militaire défensive. Ainsi, le 4 avril 1949, douze pays signent le Traité de Washington. C’est la naissance de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).
Dès sa création, l’OTAN est fondée sur un principe de défense mutuelle. L’article 5 de la charte de l’Alliance stipule que toute attaque menée à l’encontre de l’un des signataires entraînerait une riposte de l’ensemble des pays de l’organisation.
Par ce traité, les États membres s’engagent à préserver la paix et la sécurité dans le monde. Par ailleurs, ils tentent d’assurer leur défense collective, notamment face à l’Union soviétique. D’un point de vue politique, l’objectif de l’OTAN est de promouvoir les valeurs démocratiques.
L’OTAN à l’ère de la Guerre froide (1950-1991)
Au cours de la Guerre froide, l’OTAN s’élargit et le monde entre alors dans une course à l’armement nucléaire.
L’élargissement de l’OTAN : à l’origine d’une guerre des pôles ?
À partir de 1950, l’OTAN s’agrandit. La Grèce et la Turquie intègrent la coalition en 1952, précédant l’arrivée de l’Allemagne de l’Ouest (RFA) en 1955. Cette alliance marque le début de la « pactomanie » américaine, période au cours de laquelle les États-Unis multiplient les partenariats militaires dans le cadre de leur politique d’ « endiguement » du communisme.
En bon rival, pour lutter contre l’expansion du bloc occidental, l’URSS forge à son tour son alliance défensive. En 1955, le Pacte de Varsovie est créé. Il regroupe alors l’Allemagne de l’Est (RDA) et sept pays d’Europe orientale. Cette alliance économique, politique et militaire vise à s’établir en contrepoids de l’OTAN.
L’opposition de ces deux coalitions, portées par les États-Unis d’une part et l’Union soviétique de l’autre, fût au coeur du processus de bipolarisation du monde du temps de la Guerre froide. Néanmoins, il est à noter que jamais les pays membres de l’OTAN et ceux du Pacte de Varsovie ne se sont défiés frontalement lors de combats armés.
L’OTAN : coupable de la nucléarisation du monde ?
À la fin des années 1950, l’OTAN adopte la doctrine des « représailles massives ». Cette stratégie prévoit une riposte nucléaire en cas d’attaque de l’Union soviétique.
À partir des années 1960, l’accélération de la course aux armements encourage les États-Unis à perfectionner leurs technologies nucléaires. Pour le géant américain, il s’agit de maintenir un équilibre dissuasif avec le bloc de l’Est.
En 1979, le bras de fer nucléaire entre les deux superpuissances se traduit par la « crise des euromissiles ». En effet, le 12 décembre 1977, les États-Unis décident d’installer de nouvelles armes nucléaires dans certains pays d’Europe, en réponse au déploiement de missiles soviétiques à proximité des frontières des pays de l’OTAN.
Lire plus : Quel avenir pour la dissuasion nucléaire ?
L’après-Guerre froide et la redéfinition de l’OTAN (1991-2001)
À la fin de la Guerre froide, l’OTAN est maintenue et sa mission réorientée.
En 1991, le choix du maintien de l’OTAN
Au cours de la Guerre froide, l’OTAN a plutôt bien rempli sa mission puisqu’aucun conflit global n’a éclaté. En 1991, l’implosion du bloc soviétique conduit à la dissolution du Pacte de Varsovie. Néanmoins, les États-Unis maintiennent l’OTAN, ce qu’ils justifient lors du Sommet de Rome par la nécessité d’assurer la paix et la démocratie en Europe.
Au cours des années 1990, de nombreux États satellites de l’Union soviétique rejoignent l’Alliance (l’Allemagne réunifiée en 1990, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque en 1999).
Lire plus : Tout savoir sur la réunification allemande
Par le maintien de l’OTAN, les États-Unis veulent achever la Guerre froide en abolissant l’influence de Moscou. La Russie, trop faible pour réagir, opère un rapprochement avec l’organisation en 1997. Cet acte fondateur OTAN-Russie est avant tout symbolique et les deux agents s’engagent à ne plus se considérer en ennemis.
Lire plus : La Russie, 30 ans après la fin de la Guerre froide
L’OTAN, indispensable à la médiation des conflits post-Guerre froide ?
À partir de 1991 et pendant une dizaine d’années, l’OTAN projette ses forces armées hors des frontières de ses pays membres.
Sa première intervention a lieu dans le cadre de la Guerre de Bosnie (1992-1995). Entre août et septembre 1995, l’OTAN est à l’origine de bombardements aériens dans les Balkans, incitant les Serbes de Bosnie à se joindre à la table des négociations.
L’OTAN dirige aussi une opération de soutien de la paix au Kosovo depuis juin 1999. Cette manoeuvre diplomatique et militaire, appelée la KFOR, est créée au terme de la campagne aérienne de 78 jours lancée par l’OTAN contre le régime de Milosevic afin de faire cesser les violences au Kosovo.
Lire plus : Le Kosovo – un avenir possible dans l’Union européenne ?
Les évènements de 2001 : un tournant dans la stratégie de l’OTAN
Le 11 septembre 2001, le monde bascule. Les États-Unis, grands vainqueurs de la Guerre froide et fomentateurs d’un monde unipolaire, sont attaqués sur leur sol. Cet attentat, rapidement revendiqué par l’organisation terroriste Al-Qaïda, implique la mobilisation des forces de l’OTAN. En effet, l’article 5 du traité de l’Alliance est invoqué. Dès lors, les signataires apportent leur soutien militaire aux États-Unis et tous interviennent conjointement en Afghanistan.
Lire plus : Comment le 11 septembre a changé le monde ?
Au début des années 2000, l’OTAN intervient donc à plusieurs reprises au Moyen-Orient dans le cadre de la lutte des puissances occidentales contre le terrorisme.
Lire plus : Les organisations terroristes – des acteurs de la géopolitique mondiale
L’OTAN au XXIème siècle : une institution obsolète ?
Les attentats de 2001 affaiblissent grandement les États-Unis et font entrer le monde dans une ère multipolaire. Ces recompositions géopolitiques suscitent des interrogations sur l’avenir de l’OTAN.
Des tensions de Guerre froide renouvelées
La redéfinition des objectifs de l’OTAN depuis la fin de la Guerre froide s’accompagne d’un élargissement géographique progressif de l’organisation. La Bulgarie, la Roumanie, les Pays Baltes, la Slovaquie et la Roumaine rejoignent l’Alliance en 2004, suivis par l’Albanie et la Croatie en 2009. Ainsi, l’OTAN s’élargit vers l’Est et accueille dans ses rangs d’anciennes prises du Pacte de Varsovie.
Cette manoeuvre occidentale inquiète la Russie, qui se sent menacée aux portes de ses frontières. En effet, lors des négociations à propos de la réunification allemande de 1990, l’OTAN s’était engagée à ne pas poursuivre son élargissement en Europe orientale.
Les tensions montent en 2014 avec l’annexion de la Crimée par la Russie. L’OTAN voit en cette incursion une violation du droit international, qui plus est contre un pays aspirant à adhérer à l’alliance. Dès lors, les troupes armées des pays membres de l’OTAN se multiplient en Europe de l’Est : elles s’installent notamment en Pologne et aux Pays Baltes, particulièrement menacés par les velléités expansionnistes de Moscou.
Lire plus : L’OTAN entrouvre ses portes à l’Ukraine
Des différends internes qui compromettent la pérennité de l’OTAN
Depuis le début des années 2000, l’OTAN est affaiblie par des conflits internes, opposant bien souvent les États-Unis aux autres membres de la coalition.
Les discordes entre les signataires concernent principalement la politique budgétaire de l’organisation. En effet, lors du Sommet de l’OTAN au Pays de Galle en 2014, les membres de l’Alliance s’étaient engagés à réserver au moins 2% de leur PIB à l’institution d’ici 2024. Néanmoins, en 2022, 11 nations seulement ont atteint cet objectif. Dès lors, le déséquilibre se creuse entre les États-Unis et leurs alliés. Il est à noter que la puissance américaine consacre aujourd’hui 3,73% de son PIB à l’OTAN, ce qui représente 70% des dépenses totales de l’organisation. Les tensions atteignent leur paroxysme sous la présidence de Donald Trump, qui a parfois conditionné l’application de l’article 5 au respect de la « règle des 2% ».
Lire plus : Donald Trump – scandales, fortunes, parcours
Ces différends économiques s’accompagnent de désaccords diplomatiques récurrents. En effet, les décisions prises par l’OTAN se font bien souvent à l’initiative du géant américain, qui agit ponctuellement de manière unilatérale. Ce fût le cas lors du retrait des troupes états-uniennes de Syrie en 2019.
Lire plus : Le conflit syrien – les dates clés
Devant cette fracture au sein-même de l’alliance triomphante de 1991, Emmanuel Macron déclare en 2019 : « ce qu’on est en train de vivre, c’est la mort cérébrale de l’OTAN ».
L’OTAN, une alliance du siècle passé face aux émergences modernes
La montée en puissance de la Chine sur la scène internationale depuis quelques années n’est pas sans conséquences pour l’OTAN. En effet, les États-Unis cherchent désormais à s’entourer des pays membres de l’Alliance dans le cadre de leur compétition avec le géant chinois.
Lire plus : La Chine, une hégémonie crédible pour 2049 ?
Par exemple, lors du Sommet de Bruxelles en 2021, la Chine est décrite par les États-Unis comme « un défi systématique pour l’ordre international et pour la sécurité de l’OTAN ». Néanmoins, pour le moment, les pays européens considèrent davantage la Chine comme un partenaire économique que comme un rival redoutable.
Pour conclure, l’OTAN, alliance née aux prémices de la Guerre froide, a su se maintenir et évoluer malgré les changements géopolitiques majeurs des dernières décennies. Cependant, à l’aube du XXIe siècle, elle est confrontée à de nouveaux défis. L’émergence de puissances comme la Chine et le retour des tensions avec la Russie ravivent les interrogations relatives à l’utilité de l’Alliance et à son rôle de garant de la démocratie, de la paix et de la sécurité. Par ailleurs, les divergences internes entre les membres de l’institution, notamment en matière de financement et de stratégie, posent la question de la pérennité de cette cohésion. Mark Rutte, secrétaire général entrant de l’OTAN, appelle ainsi à « ne jamais tenir pour acquis le lien qui unit l’Amérique du Nord à l’Europe ».