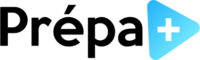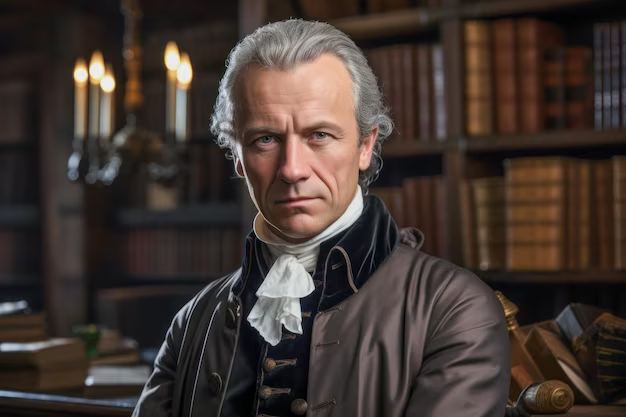Emmanuel Kant, né le 22 avril 1724 en Prusse et mort le 12 février 1804 dans cette même ville, est un philosophe prussien, fondateur du criticisme et de la doctrine dite idéalisme transcendantal.
Grand penseur de l’Aufklärung (Lumières allemandes), Kant a exercé une influence considérable sur l’idéalisme allemand, la philosophie analytique, la phénoménologie, la philosophie moderne et la pensée critique en général.
Son œuvre, considérable et diverse dans ses intérêts, est centrée autour des trois Critiques : Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique et Critique de la faculté de juger. Ces œuvres font l’objet d’appropriations et d’interprétations successives et divergentes.
Critique de la raison pure
Kant cherche à établir les limites et les capacités de la raison humaine. Il se demande comment la connaissance est possible et ce que nous pouvons connaître avec certitude. Il veut répondre à la question : « Que puis-je savoir ? ». Il ne tente donc pas de connaître un objet particulier, mais de limiter et de déterminer la portée de nos facultés de connaissance ou pouvoirs de connaître.
Distinction entre 2 types de connaissances : les jugements analytiques et les jugements synthétiques
- Les jugements analytiques sont vrais par définition.
- Les jugements synthétiques sont vrais grâce à une expérience empirique.
- La philosophie traditionnelle a négligé les jugements synthétiques, en se concentrant plutôt sur les jugements analytiques.
Il distingue 2 types de représentations : les phénomènes et les noumènes
- Les phénomènes sont les objets tels qu’ils apparaissent à nous, structurés par notre perception.
- Les noumènes sont les choses en elles-mêmes, indépendantes de notre perception.
- Nous ne pouvons jamais connaître les noumènes, mais seulement les phénomènes.
Théorie de l’a priori et de l’a posteriori
- Les connaissances a priori sont celles que nous possédons indépendamment de l’expérience (la logique).
- Les connaissances a posteriori sont celles que nous acquérons grâce à l’expérience.
- Les connaissances a priori sont nécessaires pour rendre possible la connaissance a posteriori.
Théorie de la synthèse transcendantale
- Notre esprit est capable de synthétiser des expériences en connaissances cohérentes, car l’esprit est unifié.
- C’est l’esprit / le sujet pensant qui crée le monde et c’est la pensée qui ordonne le réel.
- Le monde est un monde de représentation, de phénomène, que notre raison ne peut comprendre entièrement.
- Ça ne sert à rien de s’adonner à la métaphysique parce que nous pouvons comprendre l’essence des choses. Nous pouvons affiner notre perception avec la science, mais ça ne suffit pas.
De la même manière que Copernic a démontré que la Terre tourne autour du Soleil et non l’inverse, Kant affirme que le centre de la connaissance est le sujet connaissant (l’homme), et non une réalité extérieure à laquelle nous serions simplement passifs.
Ainsi, ce n’est plus l’objet qui oblige le sujet à se conformer à ses règles, mais le sujet qui impose ses propres règles à l’objet pour le connaître. Cela implique que nous ne pouvons pas connaître la réalité en soi (nouménale), mais seulement la réalité telle qu’elle nous apparaît sous la forme d’un objet ou phénomène.
Critique de la raison pratique : Que dois-je faire ?
Kant tente de répondre à la question : « Que dois-je faire ? » en explorant les fondements de l’éthique et de la moralité.
- La raison pratique est la capacité de raisonner sur les principes moraux et de les appliquer à notre conduite. C’est une faculté autonome et libre, capable de diriger notre volonté de manière à atteindre la moralité.
- La raison pratique est distincte de la raison théorique, qui se concentre sur la connaissance objective du monde naturel.
Théorie sur la notion de devoir
- Selon Kant, l’acte moral obéit nécessairement à un impératif catégorique (le devoir pour le devoir), et non à un impératif hypothétique (dicté par la prudence, visant le bonheur, ou procédant par habileté).
- Cela signifie que cet acte ne poursuit aucune autre fin que lui-même. On agit moralement uniquement pour agir moralement, et non par recherche d’un quelconque intérêt personnel.
Critique de la faculté de juger
Kant cherche à répondre à la question « Que puis-je espérer ? » en examinant l’esthétique et la téléologie. La troisième Critique vise principalement à combler l’abîme entre l’usage théorique de la raison, qui fonde la connaissance de la nature par l’entendement (Critique de la raison pure), et l’usage pratique de la raison, qui régit toute action morale (Critique de la raison pratique). La faculté de juger devient ainsi le point d’articulation entre la raison théorique et la raison pratique.
Distinction entre le beau et l’agréable
- L’agréable est quelque chose de subjectif, touche au sens de l’individu, c’est un jugement esthétique.
- Le beau n’est pas un avis personnel. C’est lorsque l’on attribue une qualité à l’œuvre. Le beau n’est pas restreint au goût de chacun.
- Les hommes vont avoir une perception différente des œuvres d’arts ce qui peut amener à des conflits.
- Les jugements ne sont pas fondés sur des preuves empiriques, mais sur une sorte d’intuition que nous avons à propos du monde naturel.
- Pour Kant, il existe aussi « le sublime ». Le sublime se distingue du beau en ce qu’il dépasse notre entendement.
Étude téléologique
La connaissance des fins dernières de l’humanité échappe à l’expérience, mais cela n’empêche pas de postuler l’idée de progrès à des fins morales. C’est en raison de ce même avantage pratique que Dieu est pour Kant une idée pratique.
Informations complémentaires
L’insociable sociabilité
Les êtres humains possèdent à la fois des tendances à vivre en société et des inclinations égoïstes qui les poussent à s’opposer les uns aux autres. Cette tension est bénéfique, car les conflits et les rivalités poussent les individus à se surpasser. Kant propose que l’histoire humaine peut être vue comme une progression vers une société plus juste et rationnelle, guidée par cette insociable sociabilité.
Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique
- L’histoire humaine n’est qu’une succession chaotique d’événements ou est-il possible de l’envisager comme un récit qui a un sens, qui suit un fil conducteur ? En somme, l’histoire a-t-elle un sens ?
- Kant soutient que les humains travaillent à l’accomplissement du dessein de la nature, sans en avoir conscience. Cela ne veut pas pour autant dire que les humains agissent mécaniquement, au contraire cette même nature les a dotés de la liberté du vouloir et de la raison par lesquelles ils réalisent les fins de l’humanité.
- Kant est reconnu pour avoir élaboré l’hypothèse de la formation des systèmes solaires dans les nébuleuses (Hypothèse Kant-Laplace). Selon lui, la Voie lactée pourrait être un corps en rotation, composé d’un nombre immense d’étoiles maintenues ensemble par la gravitation.
Les citations de Kant
- « J’ai limité le savoir pour laisser une place à la croyance » : en reconnaissant les limites de la connaissance, Kant laisse de la place pour la croyance rationnelle. Même si nous ne pouvons pas connaître certaines réalités métaphysiques (comme l’existence de Dieu, l’immortalité de l’âme ou la liberté), nous pouvons néanmoins les postuler comme nécessaires pour la cohérence de notre raisonnement moral.
Lire plus : Anaximandre : l’homme à l’origine de tout
Je vous donne ci-dessous plusieurs sources que je consultais en prépa pour me cultiver en philosophie :
Les Bons Profs (chaîne YouTube)