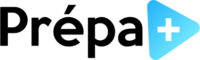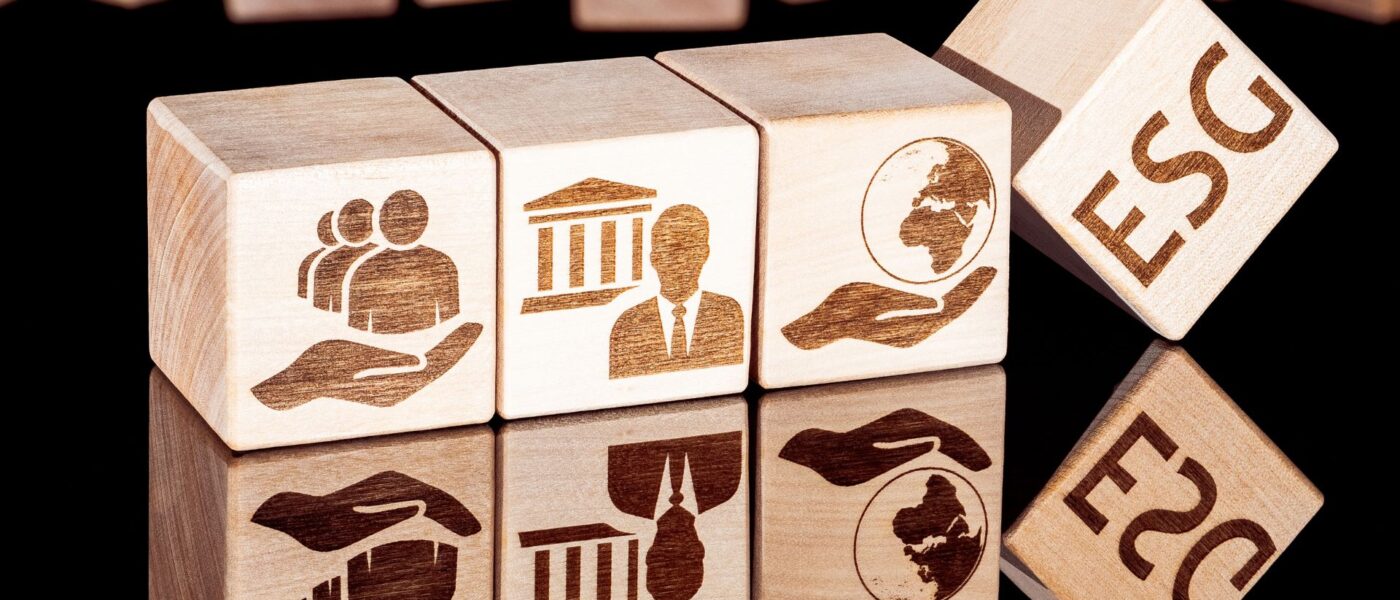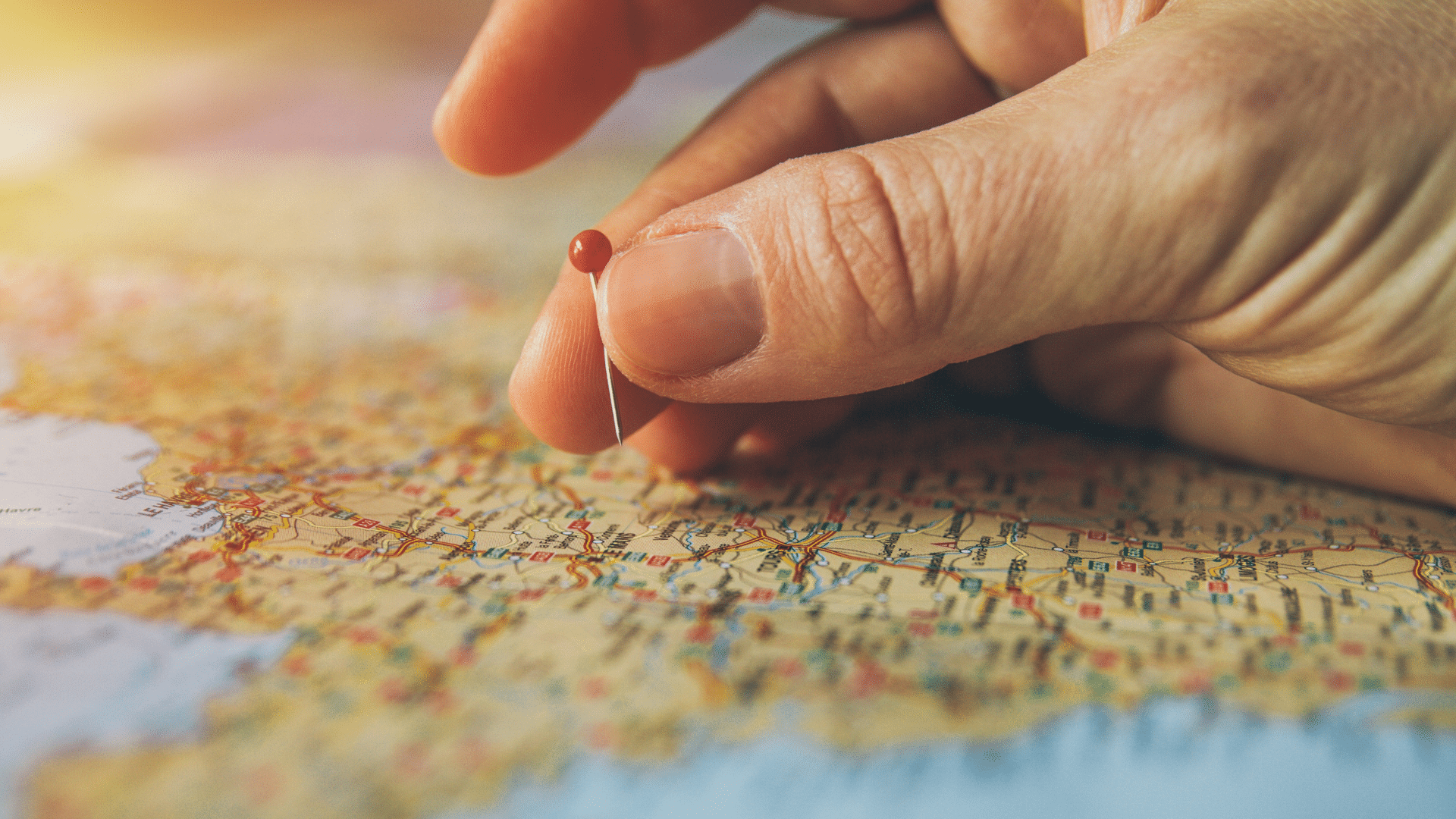Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a mis en place une série de mesures qui auront des conséquences profondes non seulement sur les États-Unis, mais aussi sur l’Amérique latine. Dans les premières heures de son second mandat, il a signé plusieurs ordonnances exécutives, dont une déclaration d’urgence nationale à la frontière américano-mexicaine. Cette décision s’inscrit dans une politique de durcissement migratoire, de déportations massives et de lutte contre les organisations criminelles latino-américaines. De plus, une mesure symbolique mais controversée vise à renommer le Golfe du Mexique en “Golfe d’Amérique”. Dans cet article de Mister Prépa, on te propose de faire un tour d’horizon des principales initiatives du président Trump et de leurs implications pour l’Amérique latine.
Lire plus : Quels enjeux géopolitiques derrière le retour de Donald Trump ?
L’urgence nationale et la militarisation de la frontière
Lors de son discours inaugural, Donald Trump a fermement condamné la politique migratoire de son prédécesseur Joe Biden, qu’il juge responsable d’une “décadence” des États-Unis. En réponse, il a proclamé l’état d’urgence nationale à la frontière mexicaine, facilitant ainsi le déploiement de l’armée pour bloquer les points de passage et intensifier les contrôles migratoires.
L’une des premières conséquences concrètes de cette décision est la reprise de la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique, projet emblématique du premier mandat de Trump. Entre 2017 et 2020, près de 700 kilomètres avaient été érigés, et la nouvelle administration entend bien poursuivre ces travaux pour renforcer la barrière physique entre les deux pays.
Par ailleurs, Trump a réintroduit la politique du “Quédate en México” (“Reste au Mexique”), obligeant les demandeurs d’asile à attendre l’examen de leur dossier sur le sol mexicain plutôt qu’aux États-Unis. Cette mesure a immédiatement suscité une réaction vive de la part du gouvernement mexicain, qui l’a qualifiée de “unilatérale” et contraire aux accords bilatéraux sur la gestion migratoire.
En outre, le président Trump a suspendu l’application “CBP One”, un outil mis en place sous l’administration Biden pour faciliter la prise de rendez-vous des migrants souhaitant solliciter l’asile. La suppression de cet outil rend l’immigration légale plus complexe et pourrait accentuer la pression migratoire sur le Mexique et d’autres pays latino-américains.
Les déportations massives et leur impact
L’une des promesses phares de la campagne de Donald Trump était d‘intensifier les déportations de migrants en situation irrégulière. Grâce à la déclaration d’urgence nationale, son administration peut allouer davantage de ressources à ces expulsions. Les États-Unis comptent environ 11 millions de sans-papiers, dont une majorité provient d’Amérique latine.
Le Congrès, désormais majoritairement républicain, soutient ces nouvelles politiques migratoires. Une loi récemment adoptée permet de déporter plus facilement les immigrés en situation irrégulière ayant commis des délits mineurs. Si l’on ne connaît pas encore l’ampleur exacte des expulsions à venir, la crainte est grande parmi les communautés latino-américaines aux États-Unis.
Des organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé ces politiques, alertant sur le sort des migrants vulnérables. Par ailleurs, des secteurs économiques américains dépendent fortement de la main-d’œuvre immigrée, notamment l’agriculture et la construction. Une étude du Pew Research Center indique que les travailleurs sans papiers représentent environ 5 % de la main-d’œuvre aux États-Unis, soulignant l’impact économique potentiel de ces déportations massives.
La lutte contre les “organisations terroristes”
Trump entend également intensifier la lutte contre le crime organisé en Amérique latine. Il a ainsi annoncé vouloir utiliser une loi du XVIIIe siècle, la “Loi des Ennemis Étrangers”, qui avait servi à détenir des citoyens japonais, allemands et italiens durant la Seconde Guerre mondiale. Cette législation permettrait de désigner certaines organisations criminelles latino-américaines, comme le cartel vénézuélien “Tren de Aragua”, comme des “groupes terroristes”. Une telle qualification leur ferait subir le même traitement que des organisations djihadistes comme Al-Qaïda ou le Hezbollah.
Cette mesure a provoqué une levée de boucliers au Mexique, car elle pourrait justifier une intervention militaire américaine sur son territoire, notamment dans les régions dominées par les cartels. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a fermement rejeté cette décision, la qualifiant d’atteinte à la souveraineté nationale.
Le changement de nom du Golfe du Mexique
Enfin, une décision symbolique mais controversée concerne la modification du nom du “Golfe du Mexique” en “Golfe d’Amérique”. Bien que ce changement n’ait pas encore été officiellement validé, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déjà adopté ce terme dans un décret régional. Ce renommage suscite de vives critiques, notamment au Mexique et à Cuba, qui partagent ce golfe avec les États-Unis. Ce geste, perçu comme une provocation nationaliste, pourrait dégrader encore davantage les relations diplomatiques entre Washington et ses voisins du sud.
Lire plus : Claudia Sheinbaum : continuité ou rupture