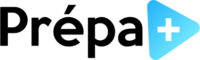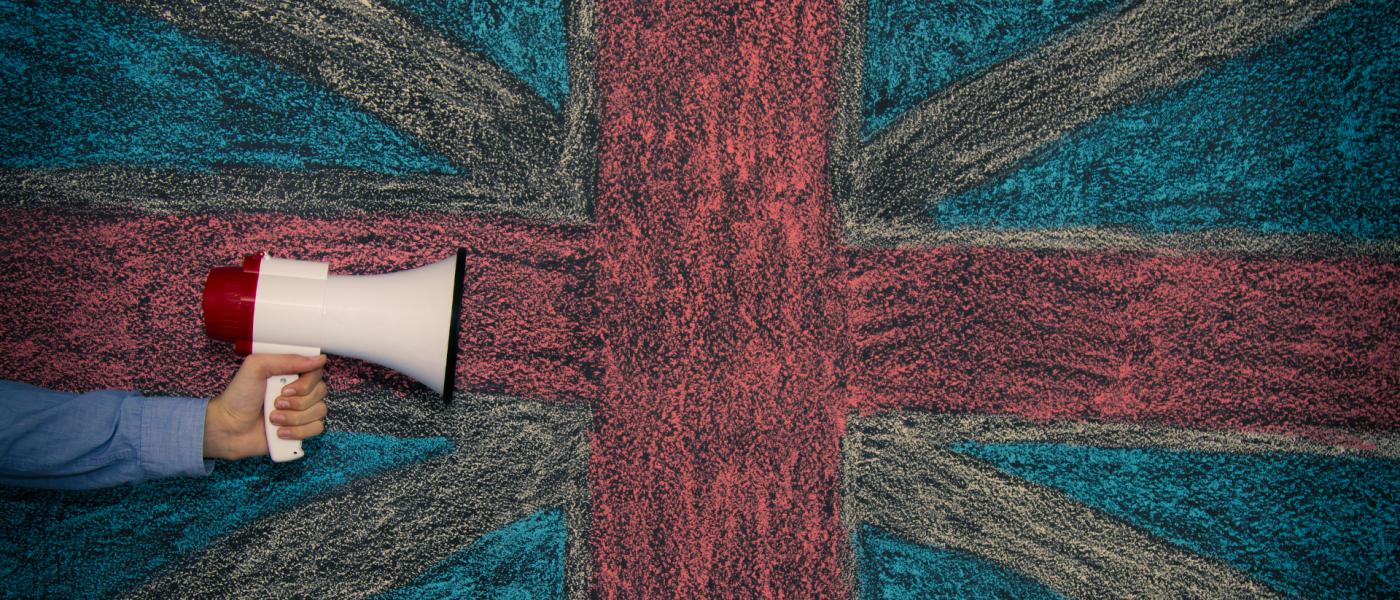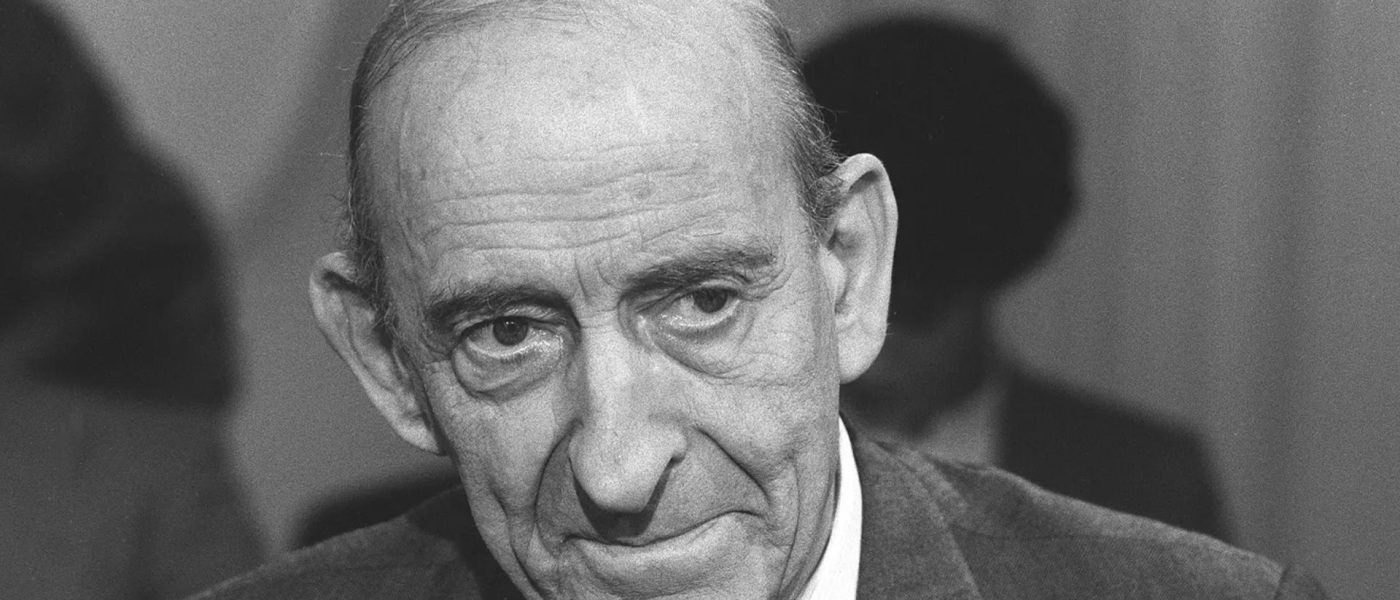Alors que l’inflation avait pratiquement disparu des radars, dans de nombreux pays développés, elle a culminé à des niveaux jamais vus depuis des décennies : près de 8,5 % aux États-Unis en mai 2022 en glissement annuel, 7,4 % en Allemagne et 4,8 % en France. La flambée des prix est en partie cyclique, du côté de la demande, notamment avec les fortes hausses liées aux plans de relance, et du côté de l’offre, avec les ruptures d’approvisionnement persistantes et exacerbées par de multiples crises. Mais au-delà de ces facteurs conjoncturels, d’autres facteurs plus persistants pourraient conduire à une sortie du régime de faible inflation que l’Occident connaît depuis 30 ans. La mondialisation qui a rendu possible la baisse des prix pourrait être durablement affectée, notamment par les tensions géopolitiques.
Après s’être concentré sur les facteurs structurels de l’inflation dans un précédent article, nous allons aborder dans cette seconde partie les objectifs contradictoires des gouvernements.
Le nerf de la guerre, c’est le pouvoir d’achat
Avec le retour de l’inflation, le gouvernement fait face à des aléas de court terme qui pourraient entrer en conflit avec ses objectifs à moyen et long terme.
Le principal problème de l’inflation à court terme est qu’elle provoque une forte baisse des salaires réels et du pouvoir d’achat des ménages. C’est pourquoi John Maynard Keynes était très anti-inflationniste et a mis en garde contre les politiques qui pourraient conduire à l’inflation. En fait, il craint que cela n’entraîne des conséquences redistributives très négatives, pénalisant les salariés, dont les salaires ne peuvent pas évoluer au même rythme que les prix, et les petits épargnants. Cet effet sur le pouvoir d’achat est actuellement observé. Aux États-Unis, les salaires réels ont baissé de 3,4 % entre avril 2021 et avril 2022. En France, les négociations salariales devraient aboutir à une hausse de 3 % pour 2022 pour une inflation annuelle estimée en juin à 5,4 %. Le fait est que plus le taux d’inflation est élevé, plus le coût social de sa réduction est élevé, car il est difficile de réduire les anticipations de hausse des prix à un niveau élevé. Donc historiquement, ce qui a primé pour faire face à ces dysfonctionnements macro-économiques, c’est la mise en place de politique d’austérité, qui ont bien souvent conduit à une hausse du chômage. C’est ce qui s’est passé dans les années 1970. Le président de la Réserve fédérale de l’époque, Paul Volcker, a relevé le taux directeur de 11 % en 1979 à 20 % en juin 1981. Si l’inflation chute alors fortement (elle se situait aux alentours de 15 % en mars 1980 et à moins de 4 % en 1983), le coût social est énorme : l’économie américaine est entrée en récession entre 1980 et 1982, et le chômage a dépassé 11 % en 1982.
Dans la situation actuelle, il est compréhensible que les responsables de la banque centrale soient prudents quant à une forte hausse des taux d’intérêt. Surtout que les gens se souviennent du précédent de 2011. À l’époque, le président de la Banque centrale européenne a relevé les taux d’intérêt en réponse à la hausse des prix de l’énergie, amplifiant l’impact négatif de ces augmentations sur la demande et la production globales. Comme les origines de l’inflation actuelle de la zone euro sont très similaires, c’est à dire une hausse des prix des matières premières due à des problèmes d’approvisionnement, le resserrement de la politique monétaire semble tout aussi délicat. Car s’il est logique que les hausses de prix soient dues à une forte demande intérieure, cela devient très problématique lorsque les hausses de prix s’expliquent par des contraintes d’offre, et plus encore lorsque ces contraintes sont globales. Une hausse des taux pourrait néanmoins réduire l’inflation importée si elle conduisait à une appréciation de l’euro.
Lire plus : L’UE émet un « avertissement général » sur le système financier
Les équilibres internes et externes
L’histoire de l’inflation et le choix de la politique économique pour y faire face est aussi un arbitrage entre équilibres internes et externes. La croissance des salaires, si elle profite à la demande et à la croissance (solde interne), peut aussi conduire à une moindre compétitivité par des coûts de production plus élevés (solde externe). Chaque gouvernement doit arbitrer entre ces deux équilibres. L’accent mis sur l’équilibre extérieur se reflète dans les politiques économiques mises en œuvre en Allemagne. C’est pourquoi, depuis 1945, au nom de la compétitivité et de la défense de son industrie, elle a choisi de réduire les salaires de manière plus ou moins conséquente. Cet attachement à la stabilité des prix est souvent associé aux souvenirs des événements hyperinflationnistes des années 1920. En réalité, il est davantage basé sur l’importance du secteur exportateur pour la croissance et les préoccupations concernant le pouvoir d’achat d’un pays où où l’épargne nationale est élevée. En fait, la stabilité des prix est un élément central du modèle industriel allemand et de sa compétitivité. Et si cette stratégie peut être mise en place pour longtemps, c’est parce qu’il y a un relatif consensus. Ainsi, de 1945 à la fin des années 2000, les salaires sont modérément défendus par les syndicats, dont les intérêts sont alignés sur ceux de l’industrie : dans la mesure où ils représentent les millions de travailleurs de l’industrie allemande, ils sont très soucieux de maintenir une industrie compétitive. La période inflationniste des années 1970 a symbolisé cet accent mis sur la compétitivité industrielle. L’Allemagne est le seul pays d’Europe occidentale à avoir réussi à stabiliser l’inflation au cours de la décennie – où les hausses de prix (5%) sont presque le double de celles de la France (10%). La recette de l’Allemagne n’est pas seulement une politique monétaire plus stricte, mais des négociations salariales, qui ont limité plus qu’ailleurs les conflits inflationnistes. Dès 1995, les Allemands ont préféré accepter la stagnation des salaires réels, où la croissance des salaires nominaux ne compenserait l’inflation que si les employeurs créaient de nouveaux emplois. Dans le secteur manufacturier, les coûts salariaux unitaires ont chuté de près de 9 % entre 1999 et 2008.
Depuis 1945, cette stratégie allemande a été menée en soutenant la balance extérieure au détriment de la balance intérieure. Pour que cela fonctionne, l’Allemagne doit en effet connaître une croissance de la demande nettement plus faible que ses principaux partenaires pour assurer un équilibre extérieur – avec un impact positif sur les exportations via la baisse des importations et le ralentissement des salaires. A l’inverse, le modèle français est basé sur la consommation, ce qui n’est pas sans rapport avec la difficulté de maintenir une industrie forte. Les désaccords avec l’Allemagne ont contraint à plusieurs reprises le gouvernement français à adopter des politiques plus strictes lorsque les contraintes extérieures sont trop fortes. C’est ce qui explique le fameux virage déflationniste de 1983 : il résulte à la fois de l’échec de la reprise en 1981 et de l’élargissement du différentiel d’inflation tout au long des années 1970. En particulier, il a été décidé de mettre fin à l’indexation automatique des salaires dans le but de ramener le taux d’inflation aux niveaux allemands.
L’arbitrage entre équilibre interne et externe est particulièrement sensible dans le contexte actuel. Face au retour de l’inflation et à la dégradation du pouvoir d’achat des ménages, la question de la hausse des salaires ne peut être envisagée sans considérer la dégradation de la part des salaires dans la valeur ajoutée et l’impact de cette hausse sur le solde extérieur, surtout dans un pays aux déficits extérieurs persistants, comme la France. A cet égard, les mesures générales prises par l’Etat (bouclier tarifaire, baisse de la taxe sur la valeur ajoutée sur les carburants) permettent de réduire l’inflation de 2 points de pourcentage, ce qui est bénéfique pour le pouvoir d’achat et la compétitivité de la France dans la zone très inflationniste.
Lire plus : Inflation, et si nous avions écouté Milton Friedman ?
La recrudescence de la dette publique
Outre l’arbitrage entre soldes internes et externes, le retour de l’inflation pourrait avoir des implications majeures sur la gestion de la dette publique, notamment dans la zone euro. Si l’inflation peut réduire la valeur réelle de la dette, elle limite aussi la marge de manœuvre des pays de la zone euro. La hausse des taux d’intérêt pourrait ouvrir la voie à une crise de la dette souveraine, rappelant les souvenirs de 2010-2012.
Tant que les taux d’intérêt sont proches de zéro, il n’est pas question de soutenabilité de la dette publique, les pays de la zone euro pouvant émettre de nouvelles dettes pour rembourser les dettes passées. Si l’environnement de taux bas réduit le risque de crise, il n’est pas exclu que la méfiance à l’égard de certains titres souverains fasse monter brutalement les taux d’intérêt. Le risque d’une telle crise semble limité par l’action de la banque centrale, qui n’a pas hésité à contrôler les taux d’intérêt à long terme depuis 2008, en prévision du durcissement de la politique monétaire au premier trimestre 2022. Cette politique implique que la banque centrale achète le montant nécessaire d’obligations d’État pour que les taux d’intérêt ne dépassent pas un certain niveau. Si la BCE n’a pas formellement adopté une telle politique, elle mène en fait une politique proche d’elle, depuis le fameux “whatever it takes” de Mario Draghi en juillet 2012, qui avait instantanément permis de réduire les écarts de taux d’emprunt entre pays européens. Cette politique s’est poursuivie avec les programmes d’achats massifs d’actifs à partir de 2015 (le quantitative easing). Officiellement, le traité de Lisbonne interdit aux banques centrales d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux pays, ou de prendre directement auprès d’eux des instruments de dette ; en fait, la monétisation de la dette publique est incontestable.
Mais il existe une légère différence entre le financement direct et le financement par l’achat d’obligations sur le marché secondaire, ce qui se traduit par des spreads plus faibles. En pratique, les banques centrales participent très activement au financement de la dette publique : entre mars 2020 et août 2020, 60 % de la dette publique émise par les pays de la zone euro ont été rachetés par leurs banques centrales. En conséquence, elle a annoncé début juin 2022 qu’elle mettait fin à son programme d’achat d’actifs, en cours depuis 2015, et a relevé ses taux directeurs pour la première fois en juillet. Ce retour de l’inflation change sensiblement la donne par rapport à la situation antérieure, car en rachetant la dette des pays de la région pouvait faire d’une pierre deux coups : relancer l’économie en maintenant bas les taux d’intérêt à long terme. Avec le retour de l’inflation, les deux objectifs deviennent contradictoires. En conséquence, les inquiétudes concernant la dette publique des pays du sud de l’Europe devraient augmenter. Avec des niveaux de dette publique dépassant 200 % du produit intérieur brut en Grèce, plus de 150 % en Italie, 123 % en Espagne, près de 50 % aux Pays-Bas et 70 % en Allemagne, il existe un risque de fragmentation dans la zone euro. De plus, les décideurs politiques sont confrontés à un dilemme : si la hausse des prix de l’énergie et des matières premières est cruciale pour la transition écologique à long terme, elle est inacceptable à court terme. La question ici n’est pas tant l’inflation elle-même que la façon dont la classe moyenne, fera face à la flambée des prix de l’énergie. Les dépenses énergétiques sont en effet très inélastiques et représentent une part importante des revenus des ménages les plus pauvres. Face à ces augmentations potentiellement durables des prix des matières premières, les deux philosophies s’opposent sur les politiques que la Commission européenne et une administration Biden mettront en œuvre. Bruxelles voit la transition écologique comme une opportunité : des programmes d’investissement à grande échelle et l’adoption de technologies plus efficaces et plus vertes peuvent stimuler la croissance économique, les salaires et la demande mondiale. Les fruits de cette croissance devraient être redistribués aux « perdants » de cette transition.
Pour Washington, ce basculement est davantage perçu comme un coût, et ses conséquences économiques doivent être limitées au maximum pour éviter des hausses excessives des prix de l’énergie, inacceptables pour la population, quitte à prendre certaines mesures controversées aux États-Unis. En conséquence, l’administration Biden a demandé à l’OPEP d’augmenter la production et a même envoyé un signal à son industrie pétrolière et gazière que davantage de forage est le bienvenu.
Lire plus : L’augmentation des taux d’intérêts directeurs, bonne ou mauvaise solution ?
Pour conclure, la difficulté pour les gouvernements est que face au retour de l’inflation, plusieurs objectifs contradictoires émergent simultanément, les contraignant à revoir leurs objectifs de transition écologique pour maintenir le pouvoir d’achat. A moyen terme et pour faire face à cette inflation, les taux d’intérêts directeurs vont obligatoirement devoir augmenter ce qui va faire planer le risque d’une crise des dettes publiques. La solution de l’équation pour un retour à la stabilité des prix, un maintien du pouvoir d’achat et une transition écologique risque d’être compliquée à trouver pour la BCE et les gouvernements.
Cet article est une synthèse du chapitre 3 (Le retour de l’inflation et des dilemmes macroéconomiques qui vont avec) de l’Economie mondiale 2023 CEPII. Il a été écrit par Thomas Grjebine.