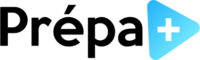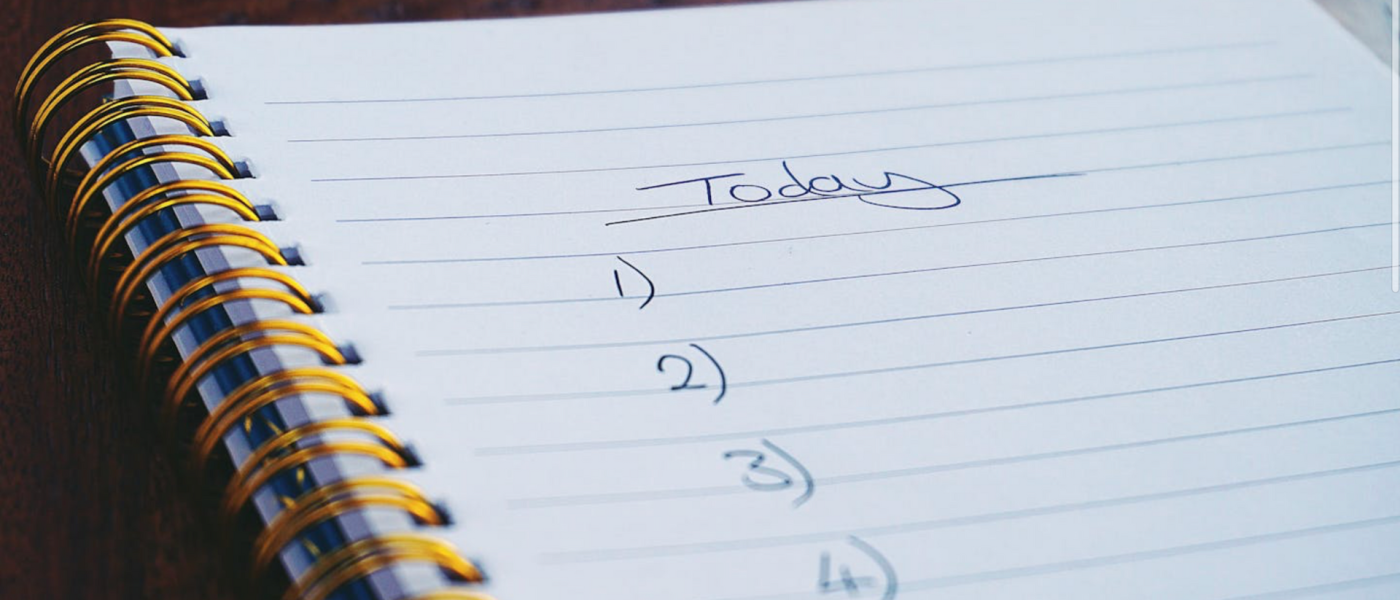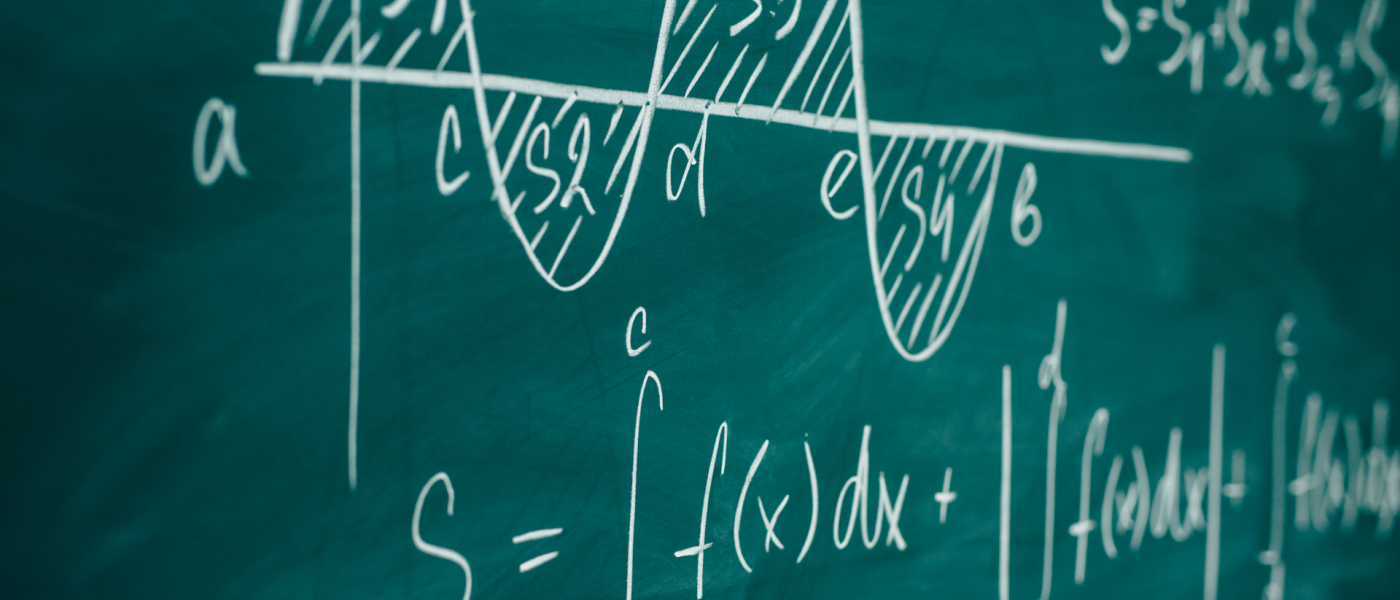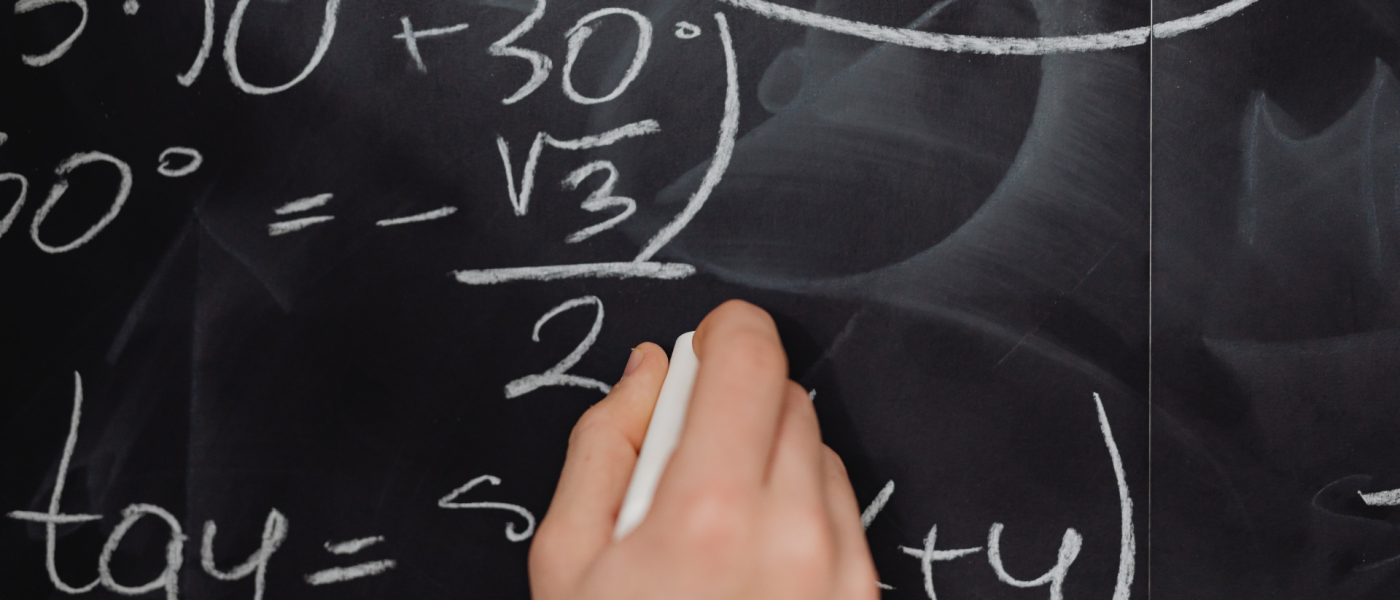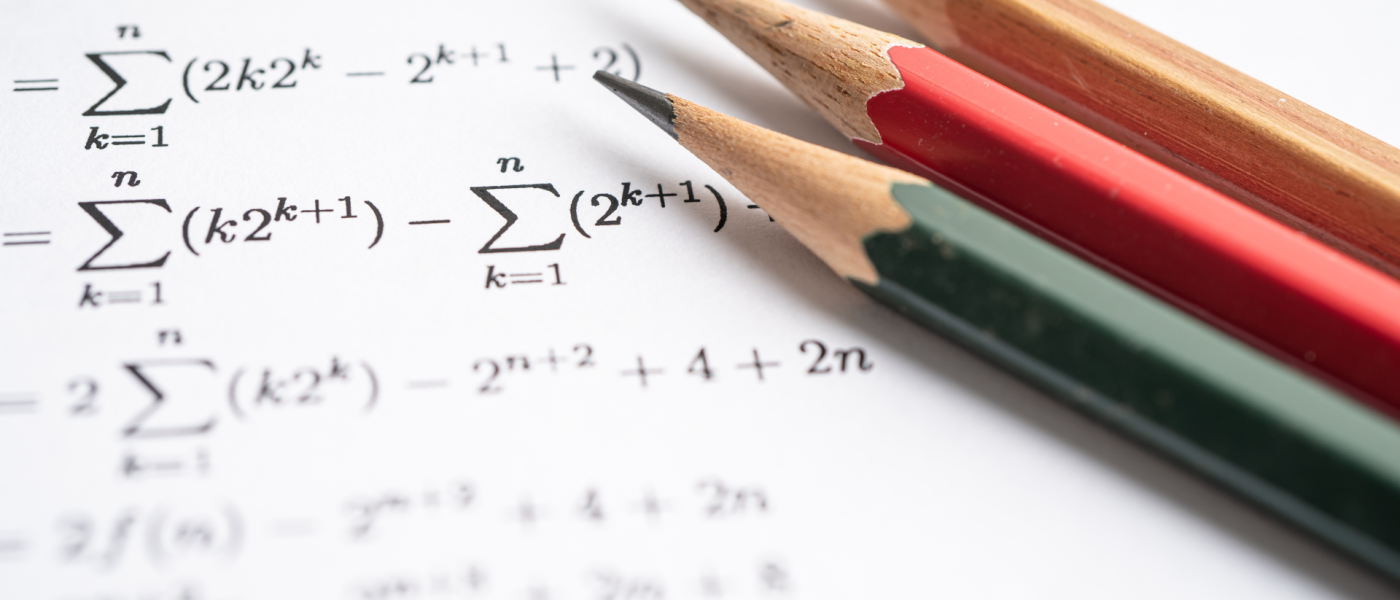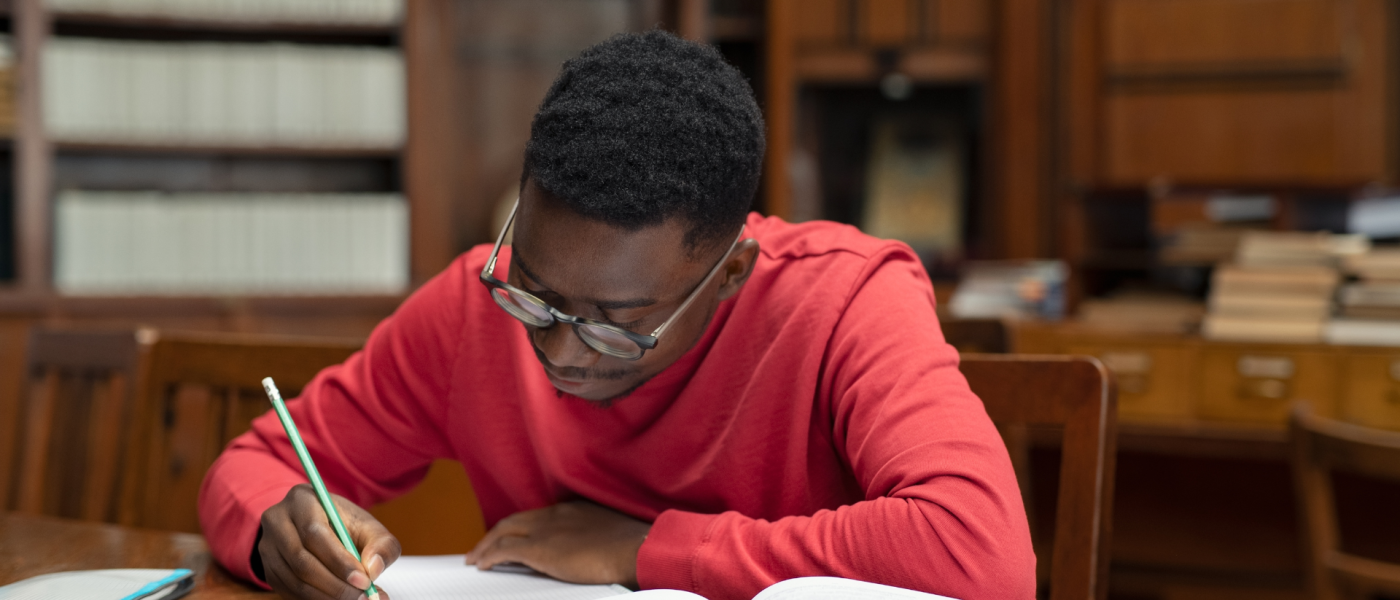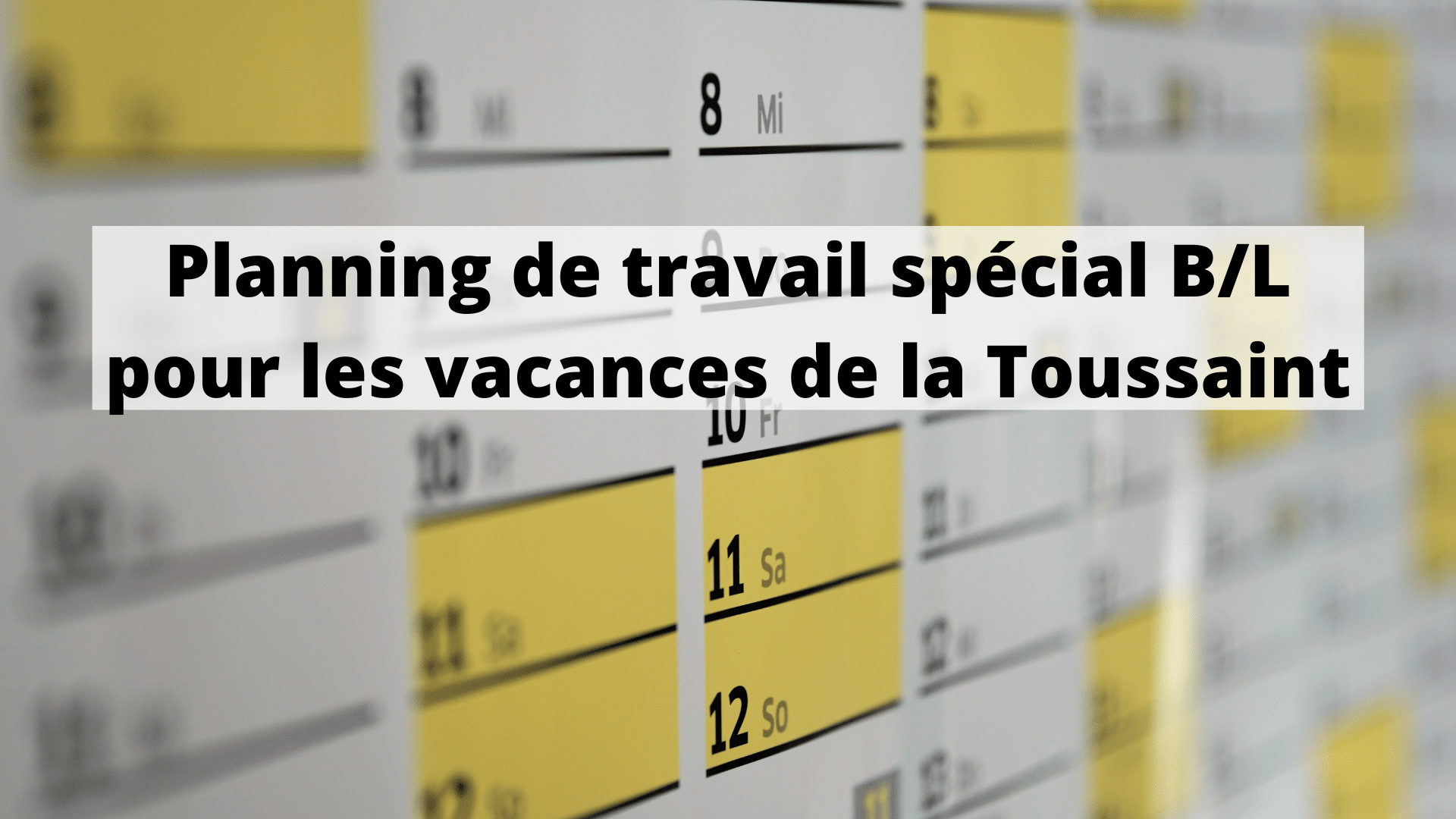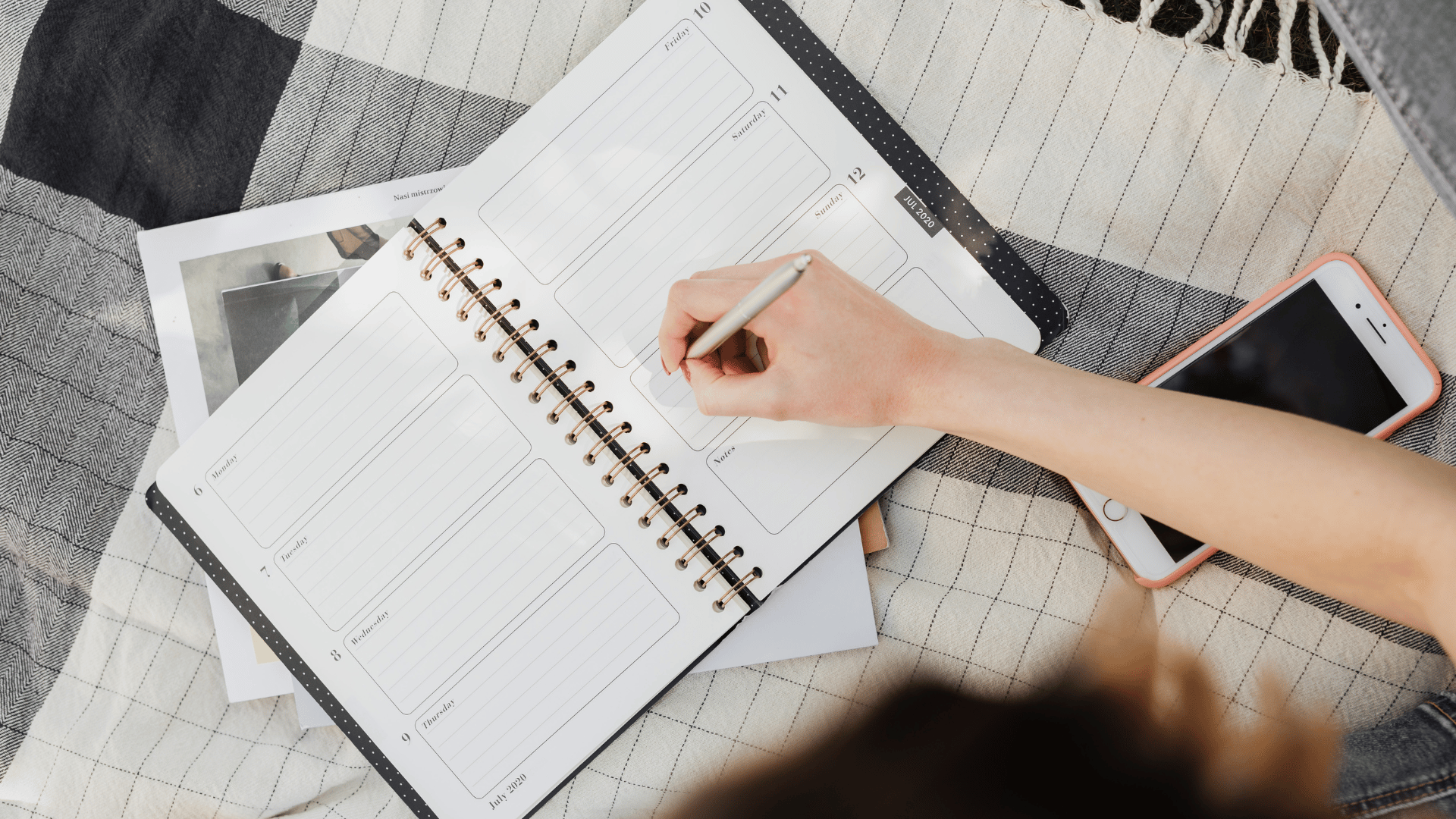Un monde aux potentialités infinies
Nous avons souvent mis en avant cette année l’importance d’une troisième partie traitant d’une évolution de l’essence même du capitalisme, une transformation en profondeur directement reliée à l’émergence de l’Internet des objets. Nous vous avons déjà proposé les idées de Jeremy Rifkin (La nouvelle société du coût marginal zéro, 2014), qui ont suscité de nombreux débats mais ont à la fois inspiré certains responsables de grandes puissances économiques (Angela Merkel et Xi Jinping par exemple).
Nous souhaitons dans cet article compléter ses idées par quelques éléments développés par Daniel Cohen (économiste et normalien) dans Le monde est clos et le désir infini (2015). Nous développons dans cet article 3 passages qui nous ont semblé particulièrement pertinents. Pour un résumé plus détaillé vous pouvez télécharger ce document :
Daniel COHEN – Le monde est clos et le désir infini (2015)
La singularité est proche
Selon Ray KURZWEIL (futurologue du MIT), un monde transhumain est en train d’advenir. Il annonce pour 2060 une transition brutale dans l’espèce humaine. Les nanotechnologies permettront à des nanobots (robots à échelle moléculaire) d’inverser le vieillissement. Il y aurait selon lui un potentiel de régénération du cerveau.
La loi de MOORE (fondateur de Intel), énoncée en 1965, selon laquelle la puissance des microprocesseurs double tous les 18 mois fait penser à une légende que rappelle KURZWEIL concernant l’invention du jeu d’échecs dans l’Inde du VIème siècle sous le règne d’un empereur Gupta. Pour féliciter l’inventeur, l’empereur lui demande quelle récompense il désire. Ce dernier lui répond qu’il souhaite qu’on recouvre l’échiquier de grains de riz en mettant 1 grain sur le premier carré, 2 sur le deuxième, 4 sur le troisième etc. (ce qui nous donne 264 – 1 grains de riz = 1.84 x 1019 grains de riz). Ainsi l’effort demandé reste raisonnable jusqu’à la moitié de l’échiquier : au 32ème carré l’empereur a déjà donné 4 milliards de grains de riz (équivalent d’un champ entier). C’est à la seconde moitié que l’empereur va comprendre sa défaite : il est ruiné. Erik BRYNJOLFSSON (prof de management au MIT) et Andrew McAffee (co-directeur au département d’économie digitale du MIT), reprennent cette anecdote dans The Second Machine Age (2014). Selon eux, nous entrons à notre tour sur la seconde moitié de échiquier, dans un monde aux potentialités infinies et dont ne nous mesurons pas davantage la portée que l’empereur parvenu à la moitié de l’échiquier.
Ainsi, pour les théoriciens de la croissance endogène, nous sommes rentrés dans une phase où les possibilités sont infinie. Selon Paul ROMER : « Les possibilités ne s’ajoutent pas, elles se multiplient ». Robert GORDON, lui-même prince des pessimistes, rappelait les erreurs de tous ceux qui avaient un jour ou l’autre annoncé la fin des innovations dans leur propre secteur. Par exemple, en 1876, un mémo de Western Union concluait que le téléphone avait trop d’inconvénients pour être un instrument de communication fiable ! Nous entrons donc sur la seconde moitié de l’échiquier.
Où va le travail humain ?
La numérisation du monde avance énormément, absorbe les emplois et bouleverse le fonctionnement des entreprises. Mais jusqu’où ira-t-elle ?
Selon Michael OSBORNE et Carl BENEDIKT, 47% des emplois sont menacés par la numérisation, surtout les professions intermédiaires : comptables, auditeurs, secrétaires..
Paraoxe de MORAVEC (années 1980) = les activités qui survivent à la numérisation sont celles qui nécessitent une bonne coordination sensori-motrice. Les auteurs nous rassurent : même si un grand nombre de tâches non routinières peuvent être numérisées grâce à d’immenses banques de données, les tâches qui requièrent le couple perception-manipulation, ou bien celles qui requièrent une intelligence créatrice, sociale ou affective sont pour l’instant protégées de l’informatisation. Exemple : le secteur du bâtiment se sert des ordinateurs mais ces derniers ne peuvent pas remplacer le travail humain de construction.
Ce paradoxe de Moravec permet à David AUTOR (économiste et prof au MIT) de montrer pourquoi la classe moyenne tend à s’effriter avec l’essor des NTIC. Il a décomposé les emplois américains en 3 niveaux : Niveau 1 = les managers, les techniciens supérieurs Niveau 2 = emplois situés au milieu de la hiérarchie sociale (contremaîtres, emplois administratifs, ouvriers qualifiés…) Niveau 3 = emplois les moins bien payés (essentiellement les services à la personne et les métiers de bouche). Selon lui, juste avant la crise de 2007, les emplois de niveau 3 ont connu une croissance à deux chiffres ! Ce sont en fait les emplois du milieu qui ont chuté : ils passent de 60% de l’emploi total en 1970 à 45% en 2012. Après la crise, ce sont bien les emplois du niveau 2 qui ont connu la croissance la plus faible, voire même négative. Selon AUTOR donc, c’est la demande d’emplois intermédiaires, plus que celle des emplois non qualifiés qui aurait diminué. Le fait que les emplois du niveau 3 progressent aurait pu conduire à une hausse de leur rémunération, mais la pression exercée par les classes moyennes en phase de délassement y a fait obstacle. Mais pourquoi une partie au moins des salariés du niveau 2 ne parviennent-ils pas à se hisser au niveau 1, le mieux rémunéré ? Une explication repose sur l’idée du « winner takes all » : tout va au gagnant ! En effet, dans le capitalisme postindustriel, les modes de rémunération tendent à tout donner au meilleur et rien au second. C’est le star-système. On l’appelle aussi l’effet Pavarotti : pourquoi acheter un autre album que celui du meilleur artiste ? Le phénomène s’observe dans tous les domaines. La société de l’information crée une économie de la réputation qui fait exploser le salaire de celui qui est considéré comme le meilleur. Ainsi, aux deux bouts du monde de l’emploi se crée une formidable asymétrie : les salaires vont en haut et les emplois vont en bas. C’est le milieu, la classe moyenne qui disparaît, ce qui marque profondément l’idéal démocratique.
La croissance disparue
– Nous avons parcouru un chemin technologique qui est considérable, à tel point que les années 1960 nous paraissent déjà être un âge de pierre. Mais tout n’a pas été pour autant brillant en matière économique : stagnation des revenus pour la grandes majorité des habitants des pays avancés. Robert GORDON est contre les idées expansionnistes des théoriciens de la croissance endogène. Il note ironiquement qu’aucune des grandes mutations annoncées par la science-fiction des années 1950/1960 ne s’est produite (voiture volante etc.). Il relativise aussi l’impact économique de l’informatisation ; selon lui, ses effets se seraient déjà dissipés ! Ainsi, du point de vue du consommateur, les grandes inventions tournent autour de Steve JOBS et de sa série d’iPod, iPhone et iPad. Alors qu’il a fallu près de deux siècles pour assécher la croissance des deux RI, il est possible que cette fois, le potentiel de la révolution informatique s’épuise beaucoup plus rapidement. De ce fait, la croissance que nous connaissons actuellement, si faible soit-elle, n’aurait rien à voir avec celle connue au cours des 200 années précédentes. Entre 1880 et 1940, le monde a vraiment changé de visage avec des inventions qui bouleversèrent réellement nos sociétés(téléphone en 1876 par Graham BELL, ampoule électrique en 1879 par Thomas EDISON, cinéma en 1895 par les frères LUMIÈRE, entre 1870 et 1900, métro aérien à Chicago et métro souterrain à New York, l’automobile qui marque la fin de l’exclusion rurale…). Nos inventions actuelles seraient alors de moindre impact sur nos modes de vie et sur la croissance que celles des deux siècles derniers, selon Gordon.
- Une autre dimension du débat porte sur la mesure du PIB. Bon nombre de la révolution numérique sont gratuits et ne figurent donc pas dans les statistiques, la croissance est donc mal mesurée. L’évolution d’Internet annonce une bonne et une mauvaise nouvelle : Internet offre des services qui ne coûtent rien, ce qui est bon pour le pouvoir d’achat, mais en même temps, cela ne crée pas d’emplois ! Ainsi Google, Facebook ou Twitter embauchent à elles trois fois moins que n’importe quelle firme automobile aujourd’hui encore (selon COHEN).
Une toute autre dimension du débat porte sur les emplois publics. Le PIB les mesure à leurs coûts. Ainsi la contribution d’un médecin hospitalier à la richesse est mesurée à proportion de son salaire, point à la ligne. Les progrès de l’espérance de vie qu’il permet d’atteindre ne seront jamais pris en compte dans le calcul de la productivité. D’aucuns expliqueront que cela sous-estime le PIB, d’autres diront le contraire.
Marx à Hollywood
– GORDON est aussi pessimiste que MARX, MALTHUS et MILL au sujet de la croissance : ces derniers ont en effet annoncé la venue d’un régime stationnaire de la croissance. La peur de la machine est ancienne. Mais les économistes de la seconde moitié du XXème siècle ont cherché à apaiser ces peurs. Emmenés par Robert SOLOW, ils affirment que les machines permettent aux ouvriers d’être plus productifs et de bénéficier ainsi des fruits de la croissance. La période des 30G en est une bonne illustration : le chômage était au plus bas alors que la mécanisation était à son comble ! Mais pour que cela aille toujours dans ce sens, il faut une condition nécessaire : une complémentarité de la machine avec le travail. Les réflexions concernant le paradoxe de MORAVEC montrent à elles seules un changement de nature du progrès technique. Elles essaient en effet de cerner ce que les machines peuvent faire à la place des travailleurs, comme s’il fallait choisir les unes ou les autres, mais impossible d’avoir les deux à la fois ! Elles témoignent d’une situation où les machines se substituent à l’emploi au lieu d’en augmenter l’efficacité, comme le fait par exemple le sucre avec le café (biens complémentaires).
– L’idée selon laquelle il y aurait une masse maximale d’emplois disponibles dans la société que l’usage des machines réduirait est facile à réfuter. En effet, le progrès technique crée du pouvoir d’achat qui peut déboucher sur de nouveaux emplois. Ainsi, dans La Machine et le Chômage (1980), Alfred SAUVY développe sa théorie du déversement : le travail doit migrer des secteurs où ma machine fait le travail vers ceux où elle ne le peut pas. Aujourd’hui, on dirait que la migration doit aller des emplois « Moravec-compatibles » qui sont susceptibles d’être codifiés numériquement, vers des emplois qui ne le sont pas. Mais, si les emplois qui survivent sont ceux que le progrès technique épargne, alors que devient le potentiel de croissance des économies ? Illustrons cela avec le modèle A/B (secteur A/secteur B) mis en évidence par SAUVY mais dont William BEAUMOL a présenté un modèle très proche pour expliquer la crise du spectacle vivant. Ls comédiens de théâtre, danseurs, musiciens d’orchestre (secteur B) ont subi dans les années 1960 la concurrence violente d’industries culturelles beaucoup plus productives (secteur A = Hollywood). Quelques stars et studios inondent le monde de produits culturels qui entrent quasi-gratuitement dans les foyers par la TV, la radio ou par le câble. À l’inverse, les comédiens habituels (secteur B) ne bénéficient d’aucun gain de productivité et ont donc un coût plus élevé. Face à deux produits substituables, l’un bon marché et l’autre cher, le choix des consommateurs est bien vite fait ! Dans ce schéma, ce sont les stars d’Hollywood qui paupérisent les comédiens de théâtre. Ils sont l’incarnation des technologies qui permettent de produire des biens sans travailleurs tandis que les comédiens sont l’incarnation des travailleurs qui produisent des biens sans technologies. Le capitaliste ici, c’est la star, celui qui commande le progrès technique. Le prolétaire, c’est le comédien, qui en subit la concurrence et doit bien souvent trouver un autre job complémentaire. Cette théorie de BEAUMOL est connue comme la maladie des coûts. Mais cette situation est différente de la transition qu’a représentée le passage de l’agriculture à l’industrie puisqu’on à là un exemple de déversement réussi car les paysans (secteur A) ont migré vers des emplois industriels (secteur B) mais ici, celui-ci était lui-même dans une phase de croissance de sa productivité. La révolution du XXème a ainsi pu cumuler deux forces : la productivité agricole et le relais qu’à représenté la productivité industrielle. Le modèle A/B permet de comprendre également pourquoi la croissance n’est pas seulement lente mais potentiellement très inégalitaire. Ainsi les USA forment en réalité deux pays en un ! Un premier enregistre une croissance de type asiatique : il est peuplé du 1% le plus riche, dont le taux de croissance est d’environ 7% depuis 30 ans.. L’autre sous-pays connaît une croissance qui se situe à des niveaux européens entre 1% et 1.5% pour les 99% restants. Et si l’on descend plus bas, pour les 90% les moins dotés, la croissance est nulle. (Emmanuel SAEZ, « Striking it richer », 2015)
- L’impact des technologies conduit à réfléchir au concept clé du capital mis en évidence dernièrement par Thomas PIKETTY (Le capital au XXIème siècle, 2013). Sur la période récente on a deux phénomènes qui se cumulent : la montée des inégalités de salaire et la montée du patrimoine financier. Le mécanisme reliant les deux peut être pensé ainsi : la montée des inégalités de revenus permet l’apparition d’une classe de nouveaux riches dont le patrimoine s’accumule. Ce capital devient une force destructrice pour les ouvriers. Il appauvrit le travail selon les mécanismes analysés par MARX : les machines achetées mettent la pression sur les ouvriers. Entre 1980 et 2010, la part du 1% le plus riche passe de 7% à 20% du revenu total aux USA, alors que la hausse est bien moindre en FRA (de 7% à 8%). Inversement, la progression du patrimoine a été beaucoup plus forte en France qu’aux USA (de 360% à 600% contre de 380% à 430%). Comment comprendre cet étonnant paradoxe ? L’économiste Étienne WASMER et ses coauteurs ont montré que c’est la hausse des prix des logements qui explique l’explosion patrimoniale. Dans la mesure où la bulle immobilière a éclaté aux USA et pas chez nous, la valeur de l’immobilier est plus élevée en France.
– Lorsque l’inflation est faible, les autorités monétaires mènent une politique laxiste en baissant les taux d’intérêt pour activer la croissance. Or, les taux d’intérêt ont du mal a descendre plus bas que zéro.. C’est à ce titre que Larry SUMMERS annonçait le retour d’une « stagnation séculaire », signe de l’incapacité des politiques monétaires à relancer l’économie. De plus, les taux d’intérêt faibles sont propices aux bulles financières. Ainsi le passage du taux d’intérêt de 10% à 1% peut potentiellement multiplier le prix d’un logement par 10 ! Ainsi aux USA les indices boursiers ont bel et bien été multipliés par 10 depuis 1980 ! Un tiers seulement de cette hausse s’explique par la hausse des profits, les deux tiers par des effets de valorisation liés en grande partie à la baisse des taux. On peut donc résumer le lien entre la hausse des patrimoines et les inégalités salariales ainsi : les logiciels font pression sur les salaires –> l’inflation chute –> les taux d’intérêt chutent –> le gagnant est le patrimoine financier ou immobilier. C’est donc la déflation salariale qui provoque la hausse du patrimoine et non l’inverse ! On voit donc bien pourquoi la croissance à l’âge numérique est faite de bulles et de krachs.
Pour plus de conseils au quotidien, retrouvez-nous sur Snapchat : mister_prepa