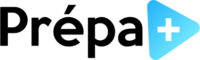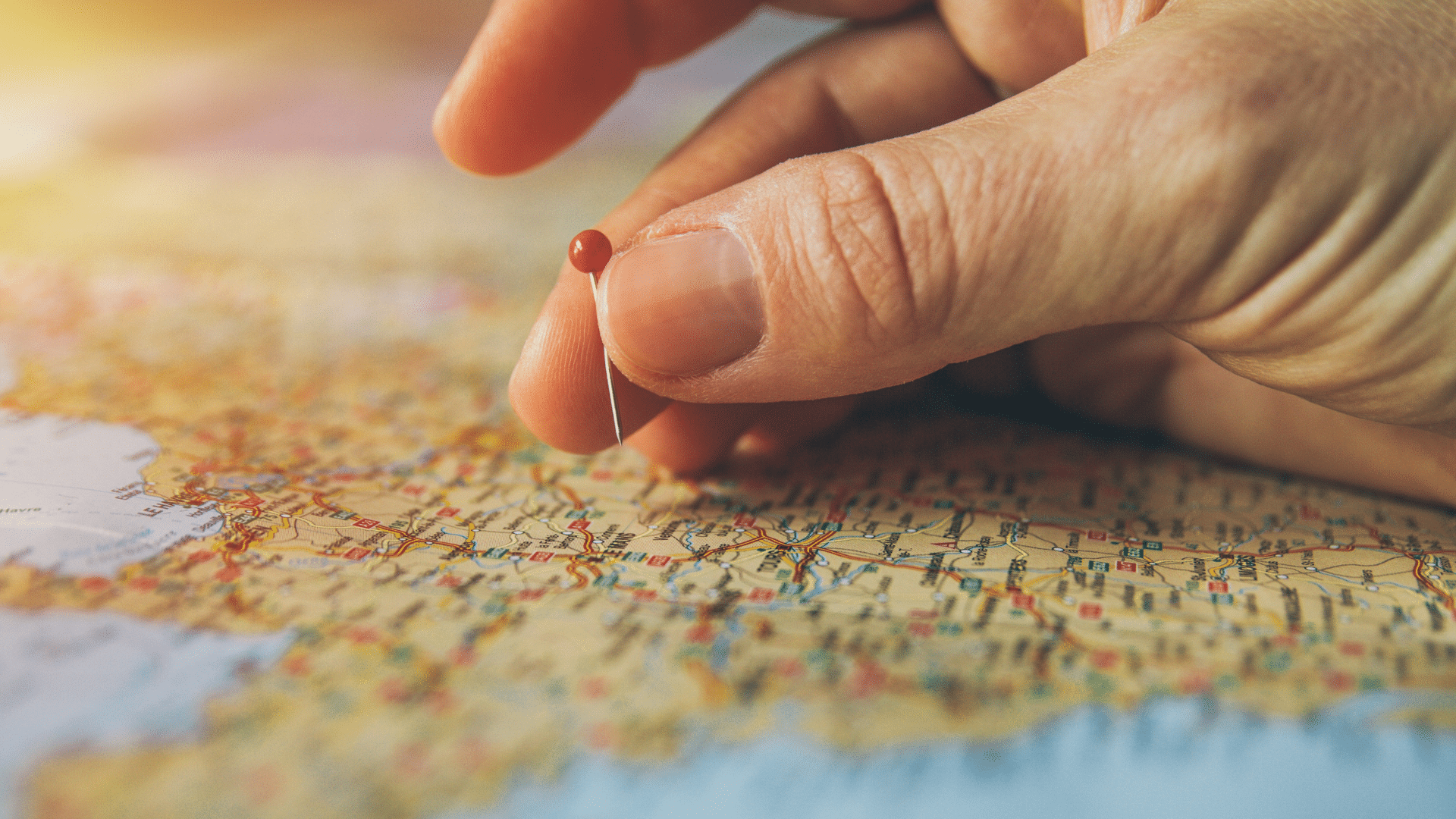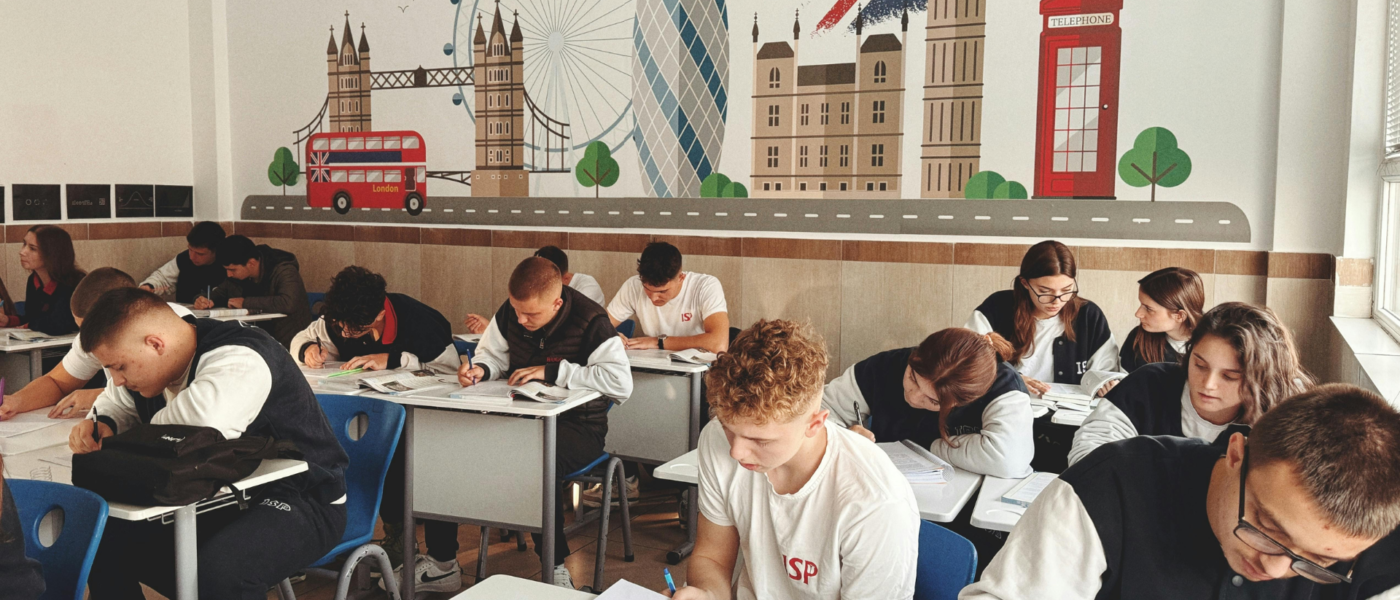Thomas d’Aquin, né en 1225 à Aquino en Sicile et mort en 1274, est un religieux italien de l’ordre dominicain, célèbre pour son œuvre théologique et philosophique.
Il est considéré comme l’un des principaux maîtres de la philosophie scolastique et de la théologie catholique. Il est également l’un des patrons des libraires. Saint-Thomas est qualifié du titre de « Docteur angélique » ou encore de « prince des scolastiques ».
Thomas d’Aquin est parti en quête d’une intelligence de la foi par la raison naturelle, en s’appuyant notamment sur la philosophie d’Aristote.
Somme théologique
La Somme théologique est un traité théologique et philosophique de Thomas d’Aquin, écrit entre 1266 et 1273, qui reste inachevé.
Relation entre la foi et la raison
La thèse de Thomas est que foi et raison ne peuvent se contredire, car elles émanent toutes deux de Dieu. La théologie et la philosophie ne peuvent donc pas parvenir à des vérités divergentes. Mieux encore, la foi se sert de la raison tout comme la grâce se sert de la nature. En d’autres termes, les vérités de la raison naturelle servent à éclairer les articles de foi, parce qu’elles donnent des raisons de croire. Selon Thomas d’Aquin : « la philosophie est la servante de la théologie ».
La philosophie permet à la théologie de rendre raison de manière fondée et rationnelle des vérités de foi qui sont inaccessibles à la raison, mais non contraires à celle-ci. La théologie, comme science supérieure, tient directement ses principes de la Révélation et se sert des conclusions de toutes les autres sciences. La philosophie, dont les fins sont ordonnées à celle de la théologie, tient ses principes de la seule raison.
Il pose comme principe le respect de l’ordre rationnel, créé et voulu par Dieu pour permettre à l’homme de connaître la vérité.
Les sens selon Saint-Thomas d’Aquin
Thomas d’Aquin se différencie partiellement du courant néo-platonicien. En effet, pour ces derniers, les sens ne fournissent que des informations trompeuses et le corps est une prison pour l’âme. Or, Thomas d’Aquin insiste sur sa conviction dans l’origine divine et la bonté de la création matérielle. Les facultés sensibles de l’homme sont donc intrinsèquement bonnes, créées sans intention de tromper, pour lui permettre d’accéder à la connaissance du Vrai et du Bien.
La finalité de l’homme selon Saint-Thomas d’Aquin
L’homme doit s’insérer dans l’ordre de l’Univers voulu par Dieu. Il doit faire ce pour quoi il a été créé : connaître et aimer Dieu. La fin de l’homme est le bonheur dans l’ordre naturel et la Béatitude dans l’ordre surnaturel. La vie morale consiste, pour chaque homme, à développer au plus haut point ses capacités et ses possibilités naturelles sous la conduite de la raison et de s’ouvrir à la vie surnaturelle offerte par Dieu.
Pour Thomas d’Aquin, toute la nature, y compris l’être humain, est orientée vers Dieu, qui est à la fois le principe, le fondement et la fin de toute chose. Dieu est identifié comme le Bien absolu par la Révélation. Tous les hommes et les créatures raisonnables atteignent leur fin ultime par la connaissance et l’amour de Dieu.
L’homme, en tant que créature raisonnable, participe à la dynamique de l’exitus-reditus. Cela désigne le fait que tout part de Dieu et y retourne. L’homme provient de Dieu et retourne à lui par des actes qui sont ordonnés selon sa nature.
Thomas d’Aquin présente une vision optimiste de l’homme et du monde. Il souligne la possibilité d’accéder au bonheur en agissant conformément à sa nature propre, sans l’aide de la Grâce. La destinée naturelle de l’homme est donc le bonheur, lequel consiste à bien agir selon sa nature.
Preuve de l’existence de Dieu
Selon Thomas d’Aquin, l’existence de Dieu n’est pas une évidence. Ce n’est pas une idée innée de l’homme. Nous ne pouvons le déduire par simple réflexion (contrairement à Descartes). Thomas d’Aquin est aristotélicien : nous n’avons pas de notion naturelle d’un être infini. Dieu n’est pas connaissable en soi, mais pour soi. En d’autres termes, nous ne pouvons connaître de Dieu que ce qu’il est pour nous, non ce qu’il est en lui-même.
Nous pouvons cependant connaître Dieu par la raison. Thomas reprend cinq voies de raisonnement pour démontrer les arguments rationnels de l’existence de Dieu.
- Les choses sont constamment en mouvement. Or, il est nécessaire qu’il y ait une cause motrice à tout mouvement. Il faut donc reconnaître l’existence d’un premier moteur, c’est Dieu.
- Nous observons un enchaînement de causes à effet dans la nature. Toutefois, il est impossible de remonter de causes à causes à l’infini. Il faut nécessairement une cause première, c’est Dieu.
- Il y a dans l’univers des choses nécessaires qui n’ont pas en elles-mêmes le fondement de leur nécessité. Il faut donc un Être par lui-même nécessaire qui est Dieu.
- Il y a des perfections dans les choses (bien, beau, amour, etc.) mais à des degrés différents. Or, il faut nécessairement qu’il y ait un Être qui possède ces perfections à un degré maximum, puisque dans la nature toutes les perfections sont limitées.
- Nous observons un ordre dans la nature, l’œil est ordonné à la vue, le poumon à la respiration. Or, à tout ordre, il faut une intelligence qui le commande. Cette intelligence ordinatrice est celle de Dieu.
Thomas d’Aquin n’avait aucunement pour but de prouver l’existence de Dieu. Son objectif était plutôt de montrer que nous pouvons accéder à Dieu au moyen de la raison naturelle, en partant de ce que l’on constate du monde.
Lire plus : Descartes : preuves que Dieu existe
Théorie de la connaissance
Thomas d’Aquin est un philosophe réaliste qui s’inspire d’Aristote pour développer sa théorie de la connaissance. Selon lui, toute connaissance commence par les sens avant d’être traitée par l’intelligence.
L’homme, composé d’un corps et d’une âme, connaît le monde en utilisant ses sens. Les sens externes (vue, ouïe, odorat, toucher, goût) permettent l’expérience du monde matériel. Les sens internes (sens commun, imagination, estimative, mémoire) traitent et synthétisent ces informations.
La connaissance sensible est perçue par les sens puis généralisée en concepts par l’intellect agent. Thomas d’Aquin critique Averroès sur la conception d’un intellect séparé et commun à tous les hommes. Au contraire, il affirme que l’intellect actif et passif sont dans une seule substance individuelle.
Informations complémentaires
La philosophie politique de Saint-Thomas d’Aquin
La communauté est naturelle à l’être humain. Thomas reprend les idées d’Aristote : “l’homme est un animal politique“.
La cité poursuit le bien suprême, elle recherche le meilleur des biens humains. Tout, dans la cité, doit permettre à l’individu de pratiquer bien sa religion. La cité doit viser le bien de la communauté, qui est supérieur au bien individuel.
Le bien commun ne doit pas être sacrifié au bien d’un seul, le bien commun est toujours plus divin que celui de l’individu. Chaque individu est une partie organique du tout que constitue la société. Chacun n’y occupe pas la même place. Il y a une structure hiérarchique entre les éléments, bien que la société vise un même bien, celui de tous.
Par ailleurs, l’amour pousse au bien, car elle élargit la sphère individuelle à une sphère communautaire. L’amour est le principe fondateur de toute sociabilité et vie communautaire. Elle repose sur le partage du bien.
Lire plus : le contrat social de Rousseau
Le libre arbitre selon Saint-Thomas d’Aquin
Il distingue deux concepts clés : le libre arbitre et la liberté. Un être est dit libre lorsqu’il est le principe de ses actes. La question de la liberté est étroitement liée à celle de l’acte volontaire et de la morale.
L’intellect, par son jugement, détermine si un objet est bon ou non. Ce jugement est totalement libre. Il s’agit d’un jugement rationnel. Les passions ne déterminent pas entièrement la volonté, car elles sont soumises au jugement de la raison.
Après que l’intellect a délibéré, la volonté entre en jeu. C’est une cause de l’acte libre, dirigeant l’intention vers sa fin. La volonté est libre, car elle est exempte de contrainte et de nécessité. Elle n’est pas influencée par des forces extérieures ou des nécessités internes, permettant ainsi le choix véritable.
Lire plus : Saint-Augustin : la Cité de Dieu
Je vous donne ci-dessous plusieurs sources que je consultais en prépa pour me cultiver en philosophie :
Les Bons Profs (chaîne YouTube)