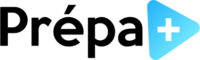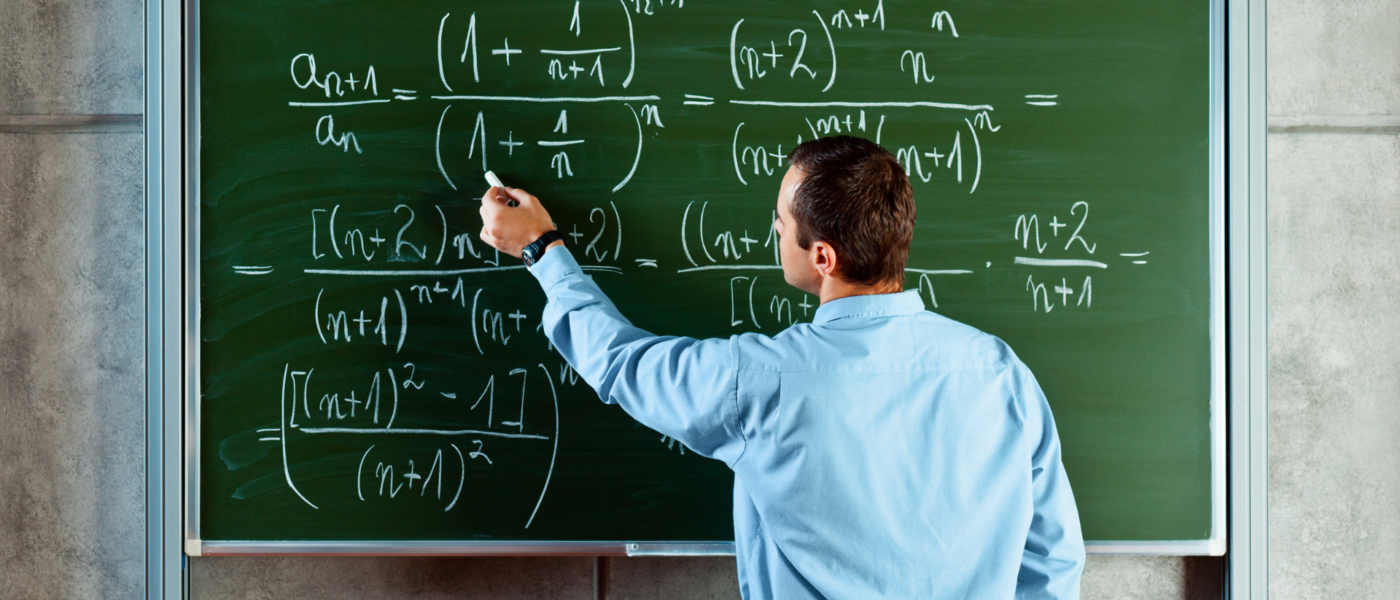On lit ou on entend souvent ces formules racoleuses utilisées par les journaux ou les sites internet : « Jésus, mythe ou réalité ? », « Instinct maternel, mythe ou réalité ? ». Ce sont des formules sans nuances qui opposent deux termes : le mythe et la réalité, et qui les rendent donc contradictoires.
Qu’est-ce qu’un mythe ?
Le mythe est un récit qui répond aux questions fondamentales que l’homme se pose sur son origine, sur la vie, sur le langage par exemple. C’est l’usage d’un langage qu’on peut qualifier de poétique et qui fait appel à des entités divines. Le mythe dit dans l’espace et dans le temps ce qui ne relève ni de l’un, ni de l’autre. Il n’est donc pas un renoncement à la rigueur, à la raison. L’interprétation du mythe se fait aussi d’une manière sérieuse et méthodique.
Il apparaît ainsi que le mythe, au sens ordinaire du terme est une croyance imaginaire, voire mensongère, fondée sur la crédulité de ceux qui y adhèrent. Le mythe est ici synonyme de fable, de conte. La philosophe Elisabeth Badinter parle par exemple du « mythe de l’instinct maternel » dans XY-De l’identité masculine. Le mythe n’aurait donc rien à nous apprendre. Mais comment expliquer alors l’étude du mythe en classe de philosophie, l’utilisation des mythes par Platon ? Il semble que lorsque le discours rationnel ne suffit plus, le recours au mythe devient nécessaire. Le mythe devient donc le moyen par lequel est communiqué un savoir par tous les membres d’une collectivité. Le mythe serait alors ce qui permet d’exprimer ce que la raison, seule, ne peut exprimer.
Ainsi, entre penser le mythe en tant que récit non-rationnel ne pouvant rien apprendre à l’homme et penser le mythe comme complément du discours rationnel, permettant ainsi l’enrichissement de la connaissance de l’homme : que nous apprennent les mythes ?
Lire plus : Philosophie, monde et religion, quelques thèses à connaître
Le mythe, récit non-rationnel et mensonger
Platon dans La République remet en cause l’idée du mythe dans ce qu’il a de fictif et de mensonger. Socrate y questionne la représentation des dieux sous des traits humains et la manière dont ils sont animés par des vices. Le philosophe critique les mythes d’Hésiode et dénonce ce qu’il appelle du « mensonge sans beauté », en faisant référence au moment où Cronos émascule Ouranos. On lui rétorque que c’est avec les mythes que l’enfant peut comprendre la complexité d’une idée, mais celui-ci argumente qu’un enfant ne saisit que les faits qu’on lui raconte de manière littérale.
Le mythe permet de palier les limites du rationnel
Mais il est aussi possible de penser une complémentarité du mythe et du discours rationnel. Par exemple, le sujet de la vie après la mort ne peut être résolu par le seul discours rationnel. L’échec de la raison demande donc l’intervention du mythe. C’est la fonction du mythe eschatologique. Dans les discours eschatologiques à la fin du Gorgias, Socrate dit à Calliclès : « Peut-être considères-tu mon récit comme un conte de vieille femme, pour lequel tu n’éprouves que du dédain. Il ne serait d’ailleurs pas surprenant que nous le dédaignions, si par nos recherches dans un sens ou dans l’autre nous pouvions trouver quelque chose de meilleur et de plus vrai. » : le récit raconté vient donc prendre la place du discours rationnel qui n’existe par pour l’instant. Mais dit la possibilité de trouver quelque chose de plus vrai sur cette question de la vie de l’âme après la mort.
Lire plus : 4 étapes pour bien analyser un sujet de philo
Une rationalité du mythe ?
Enfin, il est nécessaire d’examiner la possibilité d’une rationalité du mythe. On peut ici penser le mythe non pas comme un récit mais comme un outil logique qui éclaire la contraction de la vie humaine. C’est ce que fait Claude Lévi-Strauss dans son ouvrage Anthropologie structurale. Il y étudie les mythes à travers le structuralisme. Il y développe une analogie entre le langage et le mythe. Le langage est composé de morphèmes et de phonèmes, et le mythe de ce que Lévi-Strauss nomme « mythèmes ». Le philosophe étudie le mythe non comme un récit naïf, mais comme un ensemble structuré autour d’unités élémentaires et de relations internes : la fonction du mythe n’est donc plus historique mais symbolique. Le mythe s’avère donc être un outil logique qui opère des médiations ou des connexions entre des termes contradictoires. L’analyse structurale du mythe nous fait entièrement sortir du débat classique concernant le degré de vérité du mythe en tant qu’explication de la réalité. Le mythe n’est plus pris comme récit.