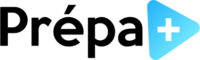Cet article et les deux prochains vont s’intéresser aux notions de dictature, de tyrannie et de totalitarisme puis tenter de cerner quels pays sont aujourd’hui aux mains d’un régime dictatorial.
L’étude se fera donc en trois temps. D’abord, et c’est l’objet de cet article, des éléments de définition de ce qu’est une dictature et un dictateur. Ensuite, il sera question des différents régimes relevant, de nos jours, de la dictature. Enfin, il faudra s’intéresser à un sujet brûlant d’actualité : celui de la Birmanie et de la prise de pouvoir, à nouveau, par une junte militaire.
La dictature semble difficile à définir : quels critères peut-on dégager pour qualifier un régime de dictature, et quelles réalités ce terme recouvre-t-il ? Un détour par la philosophie et l’histoire nous permet de répondre à ces questions.
Définitions et philosophie des dictateurs
La pensée antique
La question du bon régime et du bon dirigeant est posée dès l’Antiquité, et d’abord l’Antiquité grecque.
Platon dans La République marque un tournant dans cette pensée en montrant que l’avènement du tyran est lié aux conditions sociales et politiques de la cité et que ce dernier n’est alors pas issu d’une divinité et n’est pas un être mythique. Il existe en effet cinq types de gouvernement pour Platon, lesquels dérivent les uns des autres via un processus de dégénérescence.
- L’aristocratie, le gouvernement des meilleurs, gouvernement idéal.
- La timocratie, engendrée par l’ambition des guerriers et des magistrats : c’est pour Platon le régime de Lacédémone, un régime qui ne peut mettre de vrais sages au pouvoir et qui est dirigé par des hommes avides de richesse : ainsi l’homme timocratique est un ambitieux qui se distingue par les vertus guerrières.
- L’oligarchie, le gouvernement des riches : c’est la cupidité et l’avarice qui succède à l’ambition. Les pauvres sont exclus du pouvoir et deux Cités, une des pauvres et une des riches, se forment.
- La démocratie, le gouvernement du peuple par le peuple lui-même, et qui procède d’une révolte contre les oligarques. Platon y critique cet amour de la liberté qui entraîne une absence de responsabilité, l’homme démocratique s’abandonnant à tous les désirs : « l’anarchie [est] louée sous le nom de liberté ».
- La tyrannie, qui est dérivée de la passion extrême pour la liberté. Les enfants sont traités en égaux et finalement, les citoyens apprennent à ne plus tenir compte des lois ou des coutumes. Se constituent alors trois classes : une classe de politiciens avides qui tirent parti des deux autres, à savoir la classe d’un petit nombre parvenu à la richesse et celle du plus grand nombre, à laquelle ils savent devoir leur pouvoir. C’est ainsi que les politiciens excitent le plus grand nombre contre les plus riches et qu’ils spolient donc ces derniers, qui finissent par se révolter. De ce conflit émerge un homme qui dit vouloir restaurer l’ordre, le tyran. Il se débarrasse alors de ses ennemis par de fausses accusations, s’entoure d’une garde et finit par devenir tyran : il cultive la guerre par laquelle il se maintient au pouvoir, se débarrasse de ses proches et pille les temples.
La tragédie grecque donne déjà des exemples de tyrans : il en est ainsi dans l’Antigone de Sophocle où Tirésias assimile Créon à un tyran, celui-ci considérant la cité comme son bien privé tandis qu’un bon dirigeant devrait voir en la cité un bien commun.
Mais alors, quelle est la différence entre le dictateur et le tyran ?
En réalité, ce que nous entendons comme dictateur aujourd’hui correspond, peu ou prou, à ce qui était appelé le tyran dans la philosophie grecque. La figure du « dictateur » apparaît, elle, à partir du VIe siècle à Rome et désigne une fonction d’exception au sein de la magistrature romaine, une fonction concentrant les pouvoirs, d’une durée maximale de 6 mois et qui avait pour but la sauvegarde de la République.
Cette magistrature pouvait être invoquée pendant ou après une période de crise ayant mis en danger la République : le dernier dictateur, Jules César, obtient la dictature pour 10 ans pour reconstituer le régime après la guerre civile qui l’a opposé à Pompée Le Grand. Et c’est bien la dégénérescence de cette dictature, avec l’obtention par César d’une dictature à vie, qui nous donne notre acception de la « dictature ».
Le tyran est donc celui qui ne respecte pas les lois et s’approprie le pouvoir et les biens de la Cité, spoliant donc ses habitants, qui sont à sa merci. C’est alors la forme ultime de dégénérescence du régime politique.
La pensée moderne (XVI-XVIIIe s) et les Lumières
La définition du bon gouvernement est un thème central en philosophie politique : on connaît la fameuse phrase de Churchill « La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes ». Mais quels sont ces autres systèmes ?
L’État, en philosophie, est peu à peu vu comme une nécessité, notamment avec Thomas Hobbes dans son Léviathan pour qui l’état de nature – c’est-à-dire une situation fictive où l’État ou une quelconque autre forme de cohésion entre les individus n’existe pas – est un « état de guerre de chacun contre chacun ». Mais avec la nécessité de l’État émerge également une réflexion politique sur les limitations de l’exercice du pouvoir de l’État : la tyrannie et le despotisme sont ainsi des formes excessives, des dérives de l’État.
L’époque moderne est également celle de la Raison d’État, invoquée à partir de la Renaissance, et qui correspond au principe au nom duquel un État s’autorise à violer le droit au nom d’un critère supérieur.
Cette Raison d’État est alors le lieu d’une tension : est-ce une justification pour le pouvoir despotique ou une technique permettant de s’adapter aux nécessités et restaurer le souverain bien ?
Machiavel serait ainsi à l’origine de ce concept lorsqu’il écrit : « il est nécessaire à un prince, s’il veut se maintenir, d’apprendre à pouvoir ne pas être bon, et à en user et n’en pas user selon la nécessité ».
En effet, pour Machiavel, la force et la cruauté sont nécessaires au prince pour se maintenir. L’ambition est quelque chose de naturel chez l’homme, et dès lors, le soupçon s’installe dès lors qu’un individu dispose d’une quelconque excellence qui pourrait l’amener à convoiter le pouvoir. La personne ayant une excellence (intellectuelle, stratégique, …) doit donc user de la ruse du fait des soupçons qui pèsent sur lui, d’abord pour se protéger puis pour accaparer le pouvoir. Un cercle infernal s’impose ainsi : pour se protéger des soupçons l’homme excellent – de même que la cité excellente, à l’instar de Rome – doit s’emparer du pouvoir jusqu’à le posséder entièrement, c’est-à-dire devenir prince.
La figure du despote se dégage au XVIIIe siècle, utilisée d’abord pour désigner le souverain absolu sur le modèle oriental.
Dans une de ses Lettres persanes, Montesquieu compare le pouvoir « illimité » des princes en Perse et le pouvoir des princes en Europe. En effet, le prince perse n’est pas limité par le droit et la seule règle existante est en lui-même. Au contraire, il existe en France un droit civil et un droit public. Mais Montesquieu montre bien que le droit public est corrompu est qu’il est « une science qui apprend aux princes jusqu’à quel point ils peuvent violer la justice, sans choquer leurs intérêts. ». De plus, la monarchie, pour le philosophe, est « un état violent, qui dégénère toujours en despotisme, ou en république » : l’équilibre du pouvoir ne subsiste donc jamais longtemps, et est despotique l’État où le pouvoir est concentré dans les mains du prince.
Au cours du XVIIIe siècle se développe alors une pensée de la séparation des pouvoirs, d’abord formulée par John Locke dans son Traité du gouvernement civil (1690) qui distingue les pouvoirs législatif, exécutif et le pouvoir qui mène les relations internationales, ne s’intéressant donc pas encore au pouvoir judiciaire.
Les pouvoirs, ne doivent pas être dans la main d’un seul : la théorie est reprise principalement chez Montesquieu dans son ouvrage majeur : De l’esprit des lois (1748).
Pour Montesquieu, la détention des trois pouvoirs – les pouvoirs législatif et exécutif (décidant de la paix et de la guerre ainsi que de la sûreté de l’État) et le pouvoir judiciaire (permettant de punir les crimes et gérer les différends) – pourrait entraîner le ravage de l’État (via les deux premiers pouvoirs) et des citoyens (via le dernier pouvoir).
Montesquieu s’attarde par ailleurs sur la nécessité pour le pouvoir judiciaire d’être exercé par le peuple et l’invisibilité du magistrat : « on doit craindre la magistrature et non les magistrats ». L’État libre doit de plus assurer la liberté de fait et la liberté de droit. Il faut dès lors des règles fixes, dont on ne peut déroger et qu’au crime réponde une peine équivalente.
À l’époque moderne, et particulièrement chez les Lumières, va par ailleurs s’établir la figure du despote éclairé, résurgence du « philosophe roi » grec, celui-ci devant associer force, volonté et sagesse.
On retrouve un exemple de despote éclairé chez Frédéric II de Prusse (1712-1786), qui entretient avec Voltaire une correspondance durant quatre ans, entre 1736 et 1740. Frédéric II publie ainsi, en 1740, l’Anti-Machiavel qui réfute l’œuvre du philosophe italien et marque alors l’apothéose de la relation entre les deux hommes. Néanmoins son couronnement en 1740 et les guerres et invasions qu’il va mener vont peu à peu briser son mythe.
La pensée contemporaine : le tournant du totalitarisme
La pensée contemporaine a été véritablement marquée par la question de la dictature puis par celle du régime totalitaire. Avec l’arrivée au pouvoir de Mussolini (1922), de Staline (1928) ou de Hitler (1933) respectivement en Italie, en URSS et en Allemagne, l’Europe et ses proches voisins sont marqués par la montée de l’autoritarisme – qui va rapidement dériver vers le totalitarisme.
Les ouvrages d’Hannah Arendt – Les origines du totalitarisme (1951) – et de George Orwell – 1984 (1949) (notre livre de chevet en ces temps de pandémie) lancent véritablement la réflexion sur ce qu’est le totalitarisme.
Ainsi, Arendt tente de distinguer la dictature du totalitarisme et montre alors le caractère fondamental, pour un régime totalitaire, de l’idéologie et de la terreur.
Le totalitarisme, pour Arendt, ne peut être compris avec les outils historiques et philosophiques traditionnels : il marque une véritable rupture et n’a aucun rapport avec les autres formes politiques, y compris la dictature.
La radicalité du totalitarisme vient du fait qu’il détruit l’aptitude de l’homme à l’action et anéantit sa faculté de penser, et donc sa raison d’être. Arendt insiste alors sur l’absence de cohérence du pouvoir totalitaire, celui-ci fonctionnant, à l’instar du nazisme et du stalinisme, selon le principe de la révolution permanente.
L’idéologie, par ailleurs, correspond à l’idée qui acquiert sa propre logique et ne peut plus être arrêtée. De plus, le totalitarisme s’appuie sur les masses. En effet, le fait que la société ne soit plus stratifiée en classes – cette stratification signifierait en effet une certaine conscience de soi -, mais consiste seulement en un ensemble indifférencié d’individus trop nombreux et trop indifférents pour s’organiser est une condition de l’émergence du totalitarisme. La terreur, de masse et imprévisible, est le moyen de gagner l’adhésion des masses.
Enfin, le totalitarisme s’appuie sur la réduction de la pluralité du sens des mots, sur l’appauvrissement du langage afin de lui faire perdre la capacité qu’Arendt prête à celui-ci de créer un espace commun entre les individus et de permettre l’action.
C’est bien ce que montre George Orwell à travers la fiction d’un Oceania gouverné par un régime totalitaire dans 1984, ouvrage dans lequel il étudie notamment la systématisation du langage à travers la création de la novlangue.
Celle-ci consiste dans la simplification à l’extrême du langage – les mots n’ont plus de signification secondaire, la distinction entre mots et verbes est abolie – et dans la création de nouveaux termes censés remplacer un ensemble de concepts anciens pour les désarmer. C’est ainsi que Syme, qui fait partie de l’équipe d’experts chargés d’élaborer la onzième et dernière édition du dictionnaire de novlangue dit : « Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu’à l’os. », l’objectif étant alors ensuite expliqué : « Chaque réduction étant un gain puisque, moins le choix est étendu, moindre est la tentation de réfléchir. ».
On retrouve par exemple dans le « vocabulaire B » – qui regroupe les mots de novlangue à résonance idéologique et politique – des termes tels que « minipax » ou « joiecamp » signifiant respectivement Ministère de la Paix et Camp de travaux forcés c’est-à-dire « le contraire de ce qu’ils paraissaient vouloir dire ».
Un dernier philosophe, Michel Foucault, peut nous aider à penser l’autoritarisme. On peut ainsi s’attarder sur son analyse du panoptique, prison-modèle issue de la pensée de Jeremy Bentham, un utilitariste du XVIIIe siècle. Le panoptique permet au gardien, placé dans une grande tour située au milieu de l’édifice, de voir sans être vu, ce qui donne au détenu le sentiment d’être constamment sous surveillance. Les surveillants et autres subalternes sont également sous la surveillance de leurs supérieurs, ce qui, finalement, aboutit « à un appareil de méfiance totale et circulaire, parce qu’il n’y a pas de point absolu ».
Dès lors, le panoptisme illustre pour Michel Foucault dans Surveiller et punir le principe du pouvoir, c’est une « figure architecturale » de ce pouvoir.
En effet, pour Foucault, la société est un lieu de multiples scènes de micro-pouvoirs. Il analyse alors la discipline et la décrit comme un phénomène ambigu, qui s’insinue dans « les petites scènes de la vie quotidienne », le but étant finalement l’efficacité, et ce au détriment de la créativité. Le pouvoir se situe alors dans « le cœur de l’individu » : se croire surveiller suffit, et le panoptisme illustre bien cela.
Le panoptique peut être mis en parallèle avec le « Big Brother » placé à chaque coin de rue et dans chaque immeuble : Big Brother est une fiction qui rappelle que l’on est ou que l’on peut être constamment surveillé, notamment du fait de l’installation de « télécrans » dans les espaces privés comme publics.
De Platon à Foucault, les formes de présence de l’État et ses dérives ont été théorisées et se sont par ailleurs complexifiées : la figure du tyran a fait place à la surveillance généralisée, les rapports de discipline se sont généralisés et la tyrannie devient alors celle de plusieurs, voire celle de tous et, comme le dit Voltaire dans son Dictionnaire philosophique : « […] s’il fallait choisir, je détesterais moins la tyrannie d’un seul que celle de plusieurs. Un despote a toujours quelques bons moments ; une assemblée de despotes n’en a jamais ».
Alors, la tyrannie subsiste-t-elle de nos jours et quelles formes prend-elle ? C’est ce que nous verrons dans le prochain article.
Bibliographie :
Petit lexique de l’autoritarisme (lemonde.fr)
Voltaire, Dictionnaire philosophique (1764) : entrées Etats, Gouvernement ; Guerres ; Tyrannie
Montesquieu, De l’esprit des lois (1748)
Montesquieu, Lettres persanes (1721)
Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme (1951)
George Orwell, 1984 (1949)
Platon, La République
Revue des Etudes Grecques, Sylvain Roux, « Entre mythe et tragédie : l’origine de la tyrannie selon Platon ».
Les cours de l’Institut Viète, Félicien Challaye « La République de Platon »
Machiavel, Le Prince (1532)
Michel Foucault, Surveiller et punir (1975)